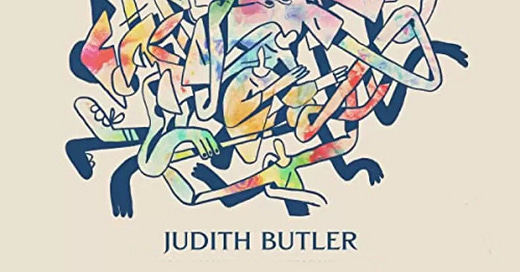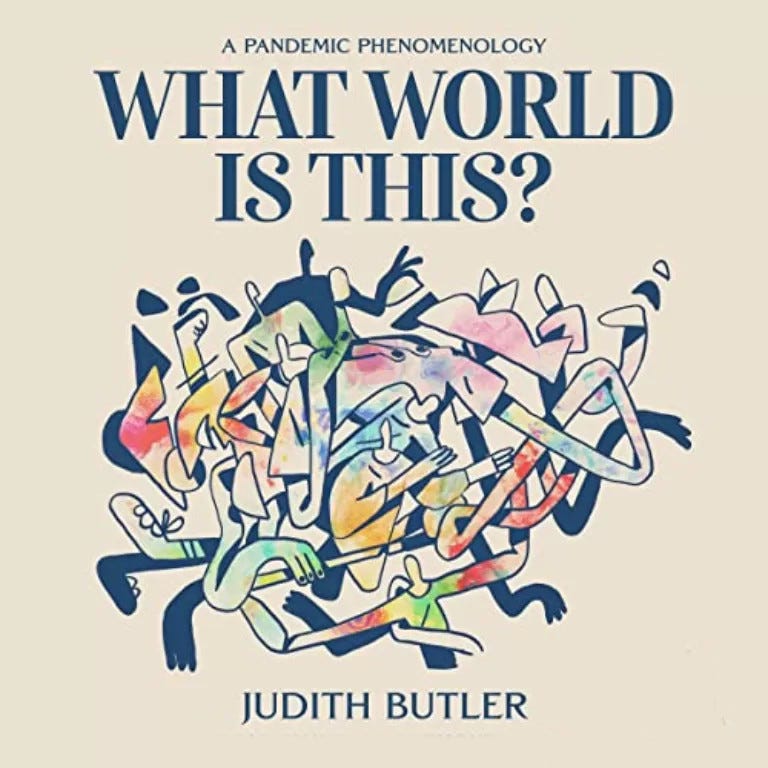Un deuil pour les vivants | Judith Butler
Lorsque l'économie redémarre à la suite d'une vague pandémique, en sachant pertinemment que certaines personnes vont mourir, une classe de personnes dispensables est identifiée et créée. C'est un moment fasciste qui émerge au sein des calculs du marché, et nous vivons une période où cette forme de calcul menace de devenir la norme. Il s'agit, en fait, d'une rationalité et d'un pouvoir que nous devons combattre à des niveaux globaux et quotidiens.
Judith Butler est une philosophe américaine et professeure à l'Université Berkeley depuis 1993. Elle est l’une des principaules théoriciennes des questions contemporaines du féminisme, de la théorie queer, de la philosophie politique et éthique. Elle a récemment publié La vie psychique du pouvoir et What world is this ? A pandemic phenomenology, dont ce texte est extrait.
· Cet article fait partie de notre dossier En deuil et en colère du 12 janvier 2023 ·
Dans mon livre La force de la non-violence (2020), je soutiens que la distinction entre ce qui est digne d'être pleuré et ce qui ne l'est pas participe pleinement de l’opération et du sens des inégalités sociales et économiques, mais est aussi l'effet, sinon l'expression, d’une violence1. Que signifie être digne d'être pleuré ? Nous pouvons penser que quelqu'un·e ou quelque chose de perdu est digne d’être pleuré·e ou non, ce qui signifie que soit iel est publiquement reconnu·e et honoré·e, soit iel passe sans laisser de trace, sans reconnaissance ou avec peu de reconnaissance. Si evidemment, un petit groupe peut pleurer une perte avec intensité et dans la durée, cette perte et ce deuil demeurent invisibles des radars dominants qui déterminent la valeur humaine. Des argumentaires comme le mien dépendent d'une conception de la "reconnaissance" qui peut apparaître ambiguë. Je m'appuie sur une conception de Freud dans "Deuil et mélancolie" selon laquelle le deuil consiste à reconnaître la perte, à accepter la réalité de la perte et à défaire les mécanismes de défense contre la connaissance de l'événement qu'est la perte elle-même. Une telle reconnaissance est une lutte qui prend du temps, un effort syncopé répété pour toucher à une perte qui peut être difficile à comprendre ou à accepter. Freud affirme que cela advient généralement petit à petit, à mesure que différents moments de la réalité confirment que quelqu'un·e ou quelque chose est irréversiblement parti. Ce n'est qu'avec le temps que nous parvenons à voir ou à ressentir que quelqu'un·e est vraiment parti·e ; dans le langage de Freud, le "verdict de la réalité" est rendu au fil du temps, alors que la non-présence de la personne est ressentie dans différentes situations2. En langage phénoménologique, on pourrait dire qu'une personne n'est désormais présente que sous la forme d'une absence irréversible. Pour Freud, la mélancolie est souvent décrite comme le refus de reconnaître qu'une perte s'est produite, généralement une forme d’un déni inconsciemment et farouchement entretenu qui prend la forme extérieure de la plainte, de l'abattement ou de l'auto-dénigrement.
La différence entre le deuil et la mélancolie semble ainsi reposer sur la question de la reconnaissance. Depuis Trouble dans la genre, j'ai cherché à étendre l'analyse de la mélancolie au-delà de la psyché individuelle pour l’appréhender comme une forme culturelle plus large qui s'installe lorsque certains types de pertes ne peuvent être reconnues ou valorisés. Dans des conditions où l'amour ou l'attachement d'une personne ne peut être reconnu et où elle perd cet amour, on ne peut reconnaître ni l'amour ni la perte. La personne se retrouve alors dans un état mélancolique, qui comprend des éléments de dépression et de manie ou qui est caractérisé précisément par l'oscillation entre les deux3. Dans le cas de la mélancolie, l'objet de la perte est important ; il peut s'agir d'une personne ou de l'amour de cette personne, mais Freud précise qu'il peut s'agir d'un idéal, d'un fantasme de ce que cette personne aurait dû être, ou même de l'idéal d'une nation. La perte de l'avantage démographique blanc dans divers États américains implique que les suprémacistes blancs doivent perdre leur fantasme de suprématie, un idéal qui n'a jamais été possible et qui n'aurait jamais dû être entretenu. En s'insurgeant contre l'égalité, iels refusent une perte qu'iels sont maintenant obligé·es de pleurer. Espérons qu'iels achèvent rapidement ce processus.
Plus tôt dans ma carrière, j'ai avancé que le genre lui-même pouvait être partiellement construit par la mélancolie, dans la mesure où certaines versions de la masculinité cis dépendent du déni de tout amour pour d'autres hommes. Pour certains, être un homme signifie précisément ne jamais avoir aimé un autre homme et ne jamais avoir perdu un homme4. Ce "jamais" aimé et perdu est un déni qui se construit au sein du genre en question, une formation mélancolique qui construit un lien inconscient entre ceux qui vivent dans cette version de la masculinité. De même, l'affirmation selon laquelle on ne serait jamais gay et qu'on ne l'a jamais été est une forme de protestation qui laisse entendre qu'une autre voix, venant d'ailleurs, promeut un point de vue contradictoire. Cette protestation détourne la reconnaissance d'une perte, mais elle peut aussi être lue comme une forme défigurée de reconnaissance. Et si les ressentis de désir homosexuel étaient considérés comme relativement communs, "endémiques" au tissu social ? Il y a quelques dizaines d'années, j'ai posé la question de savoir si une telle mélancolie de genre relevait d’un caractère culturel général et si l'on pouvait parler d'une mélancolie culturelle, que l'on trouve couramment chez les hommes hétérosexuels dont la masculinité dépend plus ou moins d'un déni inébranlable à la simple pensée de leurs éventuels désirs homosexuels. Bien sûr, nous savons qu'il existe un large éventail de masculinités dans la vie des cis, des queers et des trans qui ne correspondent pas à ce type de déni, mais peut être que ce profil de masculinité normative persiste. À cette époque, j'étais en partie guidé·e par l'étude d'Alexander Mitscherlich et Margarete Mitscherlich, Le deuil impossible, qui documente une mélancolie omniprésente dans la culture allemande de l'après-guerre5. Comme si les allemand·es ne pouvaient pas reconnaître ou faire le deuil de leurs propres pertes ou, en fait, de leur propre destructivité, et étaient pourtant hanté·es par des expériences de destruction et de perte qu'iels ne pouvaient pas vraiment nommer. L'empressement à dépasser les années du nazisme pour entrer dans le boom économique des années 1950 a entraîné une manie du marché et de sa conception particulère du futur, ainsi qu'un sentiment omniprésent de dépression, ce que Freud avait appelé, à la suite de ses prédecesseurs du début de l’époque moderne, la mélancolie, qui émerge aujourd’hui comme une pathologie culturelle.
Ces dernières années, j'ai essayé de réfléchir aux guerres et aux violences publiques contre la vie humaine et je me suis posé·e la question suivante : quelle vie peut faire l'objet d'un deuil public, et quelle vie ne le peut pas ?6 Il m'est apparu signifiant que les États-Unis ne pleurent jamais cell·eux qu'ils tuent, mais seulement leurs propres citoyen·nes, et cell·eux qui sont blanc·hes, propriétaires et marié·es plus facilement que cell·eux qui sont pauvres, homosexuel·les, noir·es, brun·es, ou sans papiers. Les êtres humains vivants portent pour ainsi dire avec ell·eux, leur appartenance à une classe susceptible d’être pleuré. Dire d'une personne vivante qu'elle peut être pleurée, c'est dire qu'elle serait pleurée si elle venait à disparaître. C'est aussi dire que le monde est, ou devrait être, organisé pour soutenir cette vie, pour soutenir l'avenir ouvert qu'elle représente. Et cell·eux qui vivent dans l’incertitude quant à l’accès à la nourriture, au logement ou aux soins de santé, vivent également avec le sentiment d'être dispensables. Vivre avec le sentiment somatique d'être dispensable, c'est avoir l'impression que l'on pourrait mourir et quitter la terre sans laisser de trace et sans être reconnu·e. C'est la conviction vécue que sa propre vie n'a pas d'importance pour les autres ou, plutôt, que le monde est organisé, que l'économie est organisée, de manière à ce que la vie de certain·es soit préservée et que celle d’autres ne le soit pas. Lorsque l'économie redémarre à la suite d'une vague pandémique, en sachant pertinemment que certaines personnes vont mourir, une classe de personnes dispensables est identifiée et créée. C'est un moment fasciste qui émerge au sein des calculs du marché, et nous vivons une période où cette forme de calcul menace de devenir la norme. Il s'agit, en fait, d'une rationalité et d'un pouvoir que nous devons combattre à des niveaux globaux et quotidiens.
Ainsi, vivre en percevant être indigne d’être pleuré·e, c'est comprendre que l'on appartient à la classe des personnes dispensables et ressentir l'abandon des institutions de soins essentielles lorsqu’elles passent à côté de nous, une fois de plus, ou sont supprimées. C’est devenir une perte dont on ne se soucie pas. Cette mélancolie participe du sentiment de fermeture de l’avenir qui accompagne la chute perpétuelle à travers les mailles du filet de sécurité, cela peut-être être accablé·e de dettes impayables, à la recherche de soins de santé insaisissables, ou soumis·e à un logement temporaire et à un revenu incertain. Si cette vie n'est pas considérée comme digne d'être sauvegardée, alors est-ce une vie sans valeur ? Ou bien la notion de "valeur" elle-même a-t-elle été détournée par une métrique dont nous devons radicalement remettre en question la valeur ? Et quel sens de la valeur est, et devrait être, accordé aux vies, et à quelle métrique appartient-elle ?
Comme je l’ai déjà dit, il n'est pas possible de comprendre les inégalités sociales sans tenir compte de la distribution inégale de la possibilité d’être pleuré·e. Cette répartition inégale est une composante clé des inégalités sociales, qui n'a généralement pas été prise en compte par les théoricien·nes du monde social. Il s'ensuit que la désignation, explicite ou implicite, d'un groupe ou d'une population comme indigne d'être pleurée implique qu'iels peuvent être la cible de violences ou qu'on peut les laisser mourir sans conséquence. Une telle caractérisation peut être induite par un ensemble de politiques et de théories et ne peut être considérée comme le résultat de la volonté délibérée d'un acteur social en particulier. Par conséquent, le type d'inégalité sociale établi par cette possibilité différentielle d’être pleuré·e peut être qualifié de violence institutionnelle. Selon moi, la lutte pour une politique non-violente est à la fois une lutte pour l'égalité de valeur des vies et contre les logiques létales, les métriques nécropolitiques, qui continuent à marquer (ou à ne pas marquer) les populations comme étant dispensables, les vies comme ne méritant pas d'être sauvegardées, les vies comme ne méritant pas d'être pleurées. Pour récapituler les deux parties de mon argumentation : (1) la lutte contre l'inégalité sociale doit être une lutte contre la possibilité différentielle d’être pleuré·e ; et (2) cette lutte fait pleinement partie d'une politique non-violente. Car la non-violence ne consiste pas seulement à s'opposer à tel ou tel acte de violence, mais aussi aux institutions, aux politiques et aux États violents qui adoptent une politique qui cible des populations pour les tuer ou les laisser mourir dans des conditions coercitives. Nous pouvons penser ici, assurément, à la politique cruelle de l'Union européenne envers les migrant·es et à sa criminalisation hideuse des acteurs humanitaires qui cherchent à préserver la vie de cell·eux qui cherchent à traverser la Méditerranée tandis que les États-nations s'y refusent.
Dans ce contexte de pandémie, il se peut que nous souffrions tous·tes d'une certaine forme de mélancolie. Comment devient-il possible de pleurer autant de personnes ? Certain·es d'entre nous savent-iels nommer ce qu'iels ont perdu ? Quel genre de symbole ou de monument public pourrait commencer à répondre à ce besoin de deuil ? Partout, nous ressentons cette absence de repère, ce vide au sein du monde sensible. Lorsque les rencontres sont elles-mêmes strictement réglementées, qu'elles sont anxiogènes ou sporadiques et néanmoins présentées comme un moyen de faire son deuil, quels moyens reste-t-il pour créer des liens ? Beaucoup ont assisté à des mémoriaux sur Zoom et perçoivent les limites de cette pratique. L'impossibilité de voir un proche à l'hôpital avant sa mort, l'impossibilité de se réunir avec cell·eux qui connaissaient cette personne, tout cela donne lieu à des expériences de perte tronquées où la reconnaissance ne peut se faire ouvertement et communautairement avec facilité. De nombreuses personnes ayant subi une perte sont revenues à leur foyer comme lieu exclusif du deuil, privées de rassemblements plus publics dans lesquels de telles pertes sont marquées et communément enregistrées. Internet a plus que jamais pris sa place en tant que nouvel espace public, mais il ne pourra jamais se substituer entièrement aux rassemblements, tant privés que publics, qui permettent d'appréhender et de vivre les pertes les uns avec les autres. Et si nous nous réunissons, nous gardons nos distances, nous essayons de nous étreindre de manière maladroite, nous nous embrassons avec un sentiment d'angoisse généralisée. Et au printemps 2022, les rassemblements commémoratifs sont devenus un autre lieu où les gens ont contracté le virus. Une forme de deuil purement privé est possible, mais peut-elle libérer ou apaiser le cri ouvert, et qu’en est-il des histoires, des chansons qui demandent au monde de témoigner de cette perte dans sa singularité au sein d'un tissu social de vies entrelacées ? Comme c'est le cas pour les pertes publiques d'une telle ampleur et qui se succèdent rapidement, il y a toujours des questions politiques qui sont liées à la demande de deuil public. Au début de la pandémie, les images des corps empilés en Équateur ou entassés dans des compartiments du New Jersey ou du nord de l'Italie nous ont fait comprendre par l’image à quel point les infrastructures hospitalières ont été dépassées et sous-financées, privées du pouvoir de soigner cell·eux qui en avaient besoin. Trop souvent, les images des mort·es et des mourant·es défilent sous forme de clips sensationnalistes. Le confinement renforce à la fois un sentiment de mort ambiant et le partage d’une pratique de défection : "Ne nous concentrons pas sur le négatif !" La tâche, cependant, est de convertir ce sentiment ambiant de perte en deuil et en revendication. Apprendre à faire le deuil d'une mort de masse signifie honorer la perte de quelqu'un·e dont vous ne connaissez pas le nom, dont vous ne parlez peut-être pas la langue, qui vit à une distance infranchissable de votre lieu de résidence, ce qui souligne le caractère global de notre désorientation. Il n'est pas nécessaire de connaître la personne perdue pour affirmer que c'était une vie. Il n'est pas nécessaire de connaître tous les détails d'une vie pour savoir qu'elle a existé. Le droit d'appartenir au monde est anonyme mais non moins essentiel pour cette raison. Dans le discours public, c'est la vie écourtée, la vie qui aurait dû avoir la chance de vivre davantage, qui retient notre attention. Les personnes âgées sont en route vers la mort (comme si le reste d’entre nous ne l’étions pas). Quel que soit l'âge, la valeur de cette personne est désormais portée dans la vie des autres, une forme de reconnaissance devient incorporation, un écho vivant, une blessure ou une trace animée qui transforme cell·eux qui vivent encore. Ce n'est pas parce que quelqu'un·e d'autre souffre d'une façon dont je n'ai pas souffert que la souffrance de l'autre est impensable pour moi. Nos liens se forgent à partir d'échos, de traductions et de résonances, de rythmes et de répétitions, comme si la musicalité du deuil parvenait à passer les frontières grâce à ses pouvoirs acoustiques. La perte que subit l'étranger fait écho à la perte personnelle que l'on ressent, même si elle n'est pas la même. Parce qu'elle n'est pas la même, elle entre en résonance. Un intervalle devient un lien. Des étrangers en deuil sont parvenu·es à former une sorte de collectivité.
Les modèles de calcul et de spéculation du marché qui ont accepté la mort d'un grand nombre de personnes comme le prix à payer pour soutenir la "santé" du marché acceptent le sacrifice de certaines vies comme un prix raisonnable, une norme raisonnable. Oui, une telle conséquence peut être qualifiée de "raisonnable" au sein de cette rationalité particulière. Parce que la rationalité de marché n'épuise pas la rationalité, parce que la rationalité calculatrice trouve sa propre limite, nous pouvons, même sans une définition stricte ou exclusive de la vie, affirmer la valeur incalculable des vies. Le dilemme est d'élaborer une notion d'égalité sociale qui incorpore cette valeur incalculable plutôt que de la nier.
C'est, en effet, dans la lecture que fait Jacques Derrida de la Crise des sciences européennes de Husserl qu'il dégage la valeur incalculable de la vie en recourant à Kant. En cherchant à comprendre " la possibilité d'un incalculable qui ne soit ni irrationnel ni discutable ", Derrida suggère
qu'une incalculabilité rationnelle et rigoureuse s'est présentée comme telle dans la plus grande tradition de l'idéalisme rationaliste. La rationalité du rationnel ne s'est jamais limitée, comme certains ont tenté de nous le faire croire, à la calculabilité, à la raison comme calcul, comme ratio, comme compte, compte à régler ou compte à rendre. Le rôle que joue la "dignité" (Würde), par exemple, dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, appartient à l'ordre de l'incalculable. Au royaume des fins, elle s'oppose à ce qui a un prix sur le marché (Marktpreis) et peut donc donner lieu à des équivalences calculables. La dignité d'un être doué de raison (la personne humaine, par exemple, et c'est, pour Kant, le seul exemple) est incalculable en tant que fin en soi.7
Même si j'aurais aimé que Kant ce soit souvenu de cet argument au moment de soutenir la peine de mort (où il affirmait que nos vies appartiennent à l'État et peuvent donc être enlevées à juste titre par l'État8), nous pouvons tourner son point de vue dans une direction plus arendtienne. Rappelez-vous, Hannah Arendt nous a dit qu'Adolf Eichmann n'avait pas le droit de décider avec qui il allait cohabiter sur la terre9. Il ne pouvait pas dire qu'il voulait vivre dans un monde sans juif·ves ou sans aucun autre groupe d'humains vivants puisque ce choix n'est pas donné aux humains. Les humain·es, selon Arendt, n'ont pas ce droit, et lorsqu'iels cherchent à effacer un groupe de personnes de la terre, iels exercent une prérogative génocidaire pour laquelle il n'y a aucune justification. Pour Arendt, les créatures humaines naissent dans une condition de cohabitation commune, marquée par une hétérogénéité ou une pluralité persistante, et cette pluralité donnée est l'horizon dans lequel nous choisissons et agissons. Mais si nous agissons contre cette pluralité donnée, nous commettons un crime contre la condition même de la vie humaine, comprise comme une vie sociale et politique. Bien sûr, il se peut que nous n'aimions pas ou ne savourions pas les liens dans lesquels nous sommes né·es, très peu d'entre nous ont la possibilité de choisir leur famille, par exemple. Mais les obligations de la cohabitation ne naissent pas toujours de l'amour ou même du choix ; les relations entre nous, cette socialité va au-delà de la parenté, de la communauté, de la nation et du territoire. Elle nous emmène plutôt dans la direction du monde. L'amour du monde bien connu d'Arendt pourrait nommer cette disposition visant à assurer les conditions de la cohabitation, mais même dans ce cas, que faisons-nous de l'énorme potentiel dont nous sommes porteur·euses pour détruire ce dont nous dépendons pour la vie elle-même ? Quel genre de créatures sommes-nous, ou quel genre de créatures sommes-nous devenu·es, qui pouvons si facilement détruire les conditions de notre propre vie ?
J'ai déjà avancé que l'interdépendance décrit une condition de vie maladroitement et nécessairement partagée, les périls et les passions de l'exposition corporelle, de la porosité, du fait de prendre ou de laisser entrer quelque chose, de laisser sortir quelque chose, d'exister, pour ainsi dire, dans ce seuil et à travers ces passages. Lorsque les inégalités sociales impliquent une plus grande probabilité de mourir, alors le portail vers l'avenir ne peut être ouvert que par une égalité sociale plus radicale et substantielle, une forme plus consciente de liberté collective, et une mobilisation de masse contre la violence dans ses formes explicites et ténues. Si nous cherchons à réparer le monde ou, en fait, la planète, alors le monde doit être libéré de l'économie de marché qui trafique et profite de sa distribution de la vie et de la mort. Une politique de la vie ne saurait être une politique réactionnaire, ni se réduire à un simple vitalisme. Elle serait davantage une réflexion critique sur les conditions partagées de la vie dans le but de réaliser une égalité plus radicale et d'honorer un engagement non-violent de caractère mondial. C'est peut-être une façon de recommencer le monde, alors même que ce monde est déjà en marche, de réparer en avançant, pour ainsi dire, alors qu'un nouvel imaginaire émerge des hantises du présent, de l'horizon liminal de ce monde.
Publication originale (11/2022) :
Columbia University Press
· Cet article fait partie de notre dossier En deuil et en colère du 12 janvier 2023 ·
Judith Butler, The Force of Nonviolence: An Ethico- Political Bind (London: Verso, 2020).
Sigmund Freud, “Mourning and Melancholia,” in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 14, trans. James Strachey (London: Hogarth, 1957), 255.
Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion on Identity (New York: Routledge, 1990), 73– 84.
Butler, Gender Trouble, 88.
Alexander Mitscherlich and Margarete Mitscherlich, The Inability to Mourn: Principles of Collective Behavior, trans. Beverley R. Placzek (New York: Grove, 1975).
Judith Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence (London: Verso, 2004); and Judith Butler, Frames of War: When Is Life Grievable? (London: Verso, 2009).
Jacques Derrida, “The ‘World’ of the Enlightenment to Come (Exception, Calculation, Sovereignty),” trans. Pascale- Anne Brault and Michael Naas, Research in Phenomenology 33 (2003): 25.
See Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, ed. and trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 6:318– 6:320, 6:311– 6:335.
Cf. Judith Butler, “Hannah Arendt’s Death Sentences,” Comparative Literature Studies 48, no. 3 (2011): 280– 295.