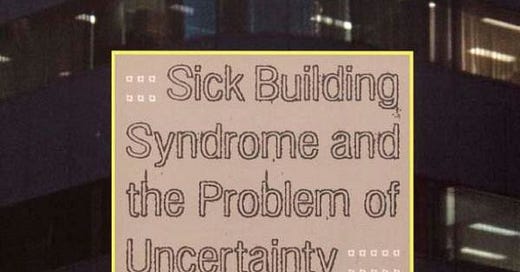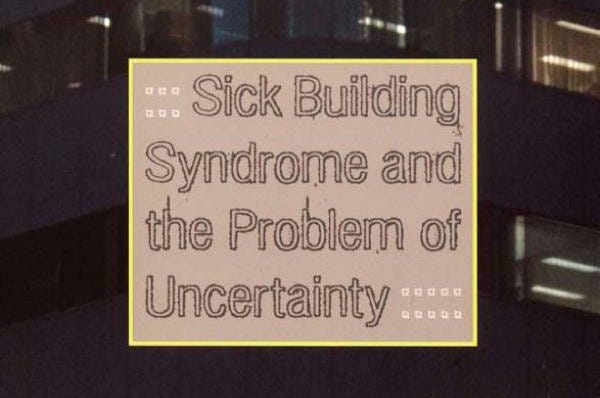La pollution intérieure au croisement de la toxicologie et de l'épidémiologie populaire | Michelle Murphy
Face à l'échec de la toxicologie et aux accusations d'hystérie, de quels moyens disposaient les travailleuses désireuses de faire valoir la présence et la nature des expositions chimiques au vingtième siècle ? Les femmes des classes populaires et à faibles revenus, et non les réformatrices de la classe moyenne, ont été les principales praticiennes de l'épidémiologie populaire. Et bien qu'elle ait été rendue possible, dans un certain sens, par la vulgarisation du calcul des risques, l'épidémiologie populaire offrait une alternative au format extrêmement ciblé et technique des études médicales. Les outils et les pratiques de l'épidémiologie populaire étaient peu coûteux et facilement disponibles dans la vie quotidienne. Il serait faux de dire que les épidémiologistes populaires étaient opposées à l'utilisation de tests diagnostiques, mais leur méthode de collecte de connaissances intimes et anecdotiques par le biais du porte-à-porte constituait une critique implicite des études étroitement techniques et impersonnelles qui dominaient les enquêtes et les débats scientifiques. Les épidémiologistes populaires n'étaient pas contre la science, mais pour l'accessibilité des connaissances et l'implication de la communauté.
Michelle Murphy est professeure adjointe au Département d'histoire et au Women and Gender Studies Institute de l'Université de Toronto. Elle a notamment publié Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty (2006), Seizing the Means of Reproduction (2012), et The Economization of Life (2017).
· Cet article fait partie de notre dossier Épidémiologie populaire du 21 avril 2023 ·
Décomposez un immeuble de bureaux de la fin du XXe siècle en une multitude de matériaux produits en masse. L'étendue et la variété des produits qui composent ces bâtiments carrés omniprésents sont étourdissantes. Des pulvérisations d'antirouille et d'ignifugeant s'accrochent aux squelettes en poutrelles d'acier. Des fils gainés de plastique et des conduits enduits de mastic serpentent au milieu d'un arc-en-ciel de fibres isolantes. Le formaldéhyde et l'adhésif préservent et maintiennent les placages de contreplaqué et de panneaux de fibres. À la fin du millénaire, les matériaux de construction provenaient plus souvent du chaudron d'un fabricant que d'un arbre ou d'une pierre.
Prenons l'exemple de la moquette de bureau, encore couramment utilisée, qui est fabriquée par lots de plusieurs millions de mètres carrés. La moquette en peluche, fabriquée en nylon, polyester ou polypropylène, n'est pas tissée mais collée sur un support en latex, en chlorure de polyvinyle ou en résine d'hydrocarbure avec du styrène-butadiène, puis pulvérisée avec un fongicide, un retardateur de taches et un produit ignifuge. Un autre adhésif à base de solvant a collé la moquette au sous-plancher en contreplaqué. Chacun de ces éléments - moquette, support, colle - était à un moment donné de sa fabrication un mélange liquide de molécules, dont les ingrédients exacts ont été bricolés dans les laboratoires industriels : styrène, 1,2 dichloroéthane, éthylbenzène, toluène, 1,1,1-trichloroéthane et xylènes, pour n'en citer que quelques-uns. Une fois déroulée, la moquette apparemment solide « dégage » dans l'air des bouffées des produits chimiques qui la composent. Des molécules et de minuscules particules s’échappent de la moquette et rejoignent l'air à une densité suffisamment élevée pour que l'on donne un nom vernaculaire à ce que les scientifiques appellent le 4-phénylcyclohexène : "l'odeur de la moquette neuve". La révolution des matériaux de construction synthétiques produits en masse, qui a débuté dans l'après-guerre, a apporté des changements spectaculaires à l'environnement bâti de la vie quotidienne - selon les termes de la campagne publicitaire de DuPont : "De meilleures choses pour une meilleure vie [...] grâce à la chimie".
Les travailleur·euses parfumé·es, les vapeurs des matériaux de construction et les fumées des équipements de bureau ont constamment ajouté des constituants moléculaires à l'atmosphère intérieure. L'ensemble des molécules constituant l'"air" pénètre inévitablement dans la bouche et le nez, passant dans la trachée puis dans les poumons. Outre l'oxygène et le dioxyde de carbone, d'autres molécules - aérosols, composés organiques volatils et autres molécules solubles dans les lipides - se diffusent à travers la paroi des alvéoles et passent dans le sang. Les molécules qui composaient l'odeur de la moquette neuve se sont fondues dans les corps. L'odorat n'est pas comme le toucher. Il ne s'agit pas d'une rencontre entre deux objets à la surface, mais d'une pénétration dans le corps d'ingrédients ayant appartenu à un autre objet. Les protagonistes de ce chapitre - molécules et produits chimiques - dépendaient des toxicologues et des hygiénistes industriel·les, ainsi que des travailleur·euses, pour rendre perceptibles leurs voyages de l'environnement vers les corps.
Dans les années 1980 et 1990, des milliers de travailleur·euses dans des centaines d'immeubles de bureaux américains se sont inquiété·es d'être exposé·es à des produits chimiques nocifs. Avec des revendications et des manifestations qui ont souvent captivé les médias locaux, des foules d'employé·es de bureau ont déclenché des enquêtes de l'Institut national de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health). Au cours de ses sept premières années d'existence, de 1971 à 1978, le NIOSH n'a reçu que six demandes d'évaluation des risques sanitaires pour des bâtiments non industriels. De 1978 à 1980, ce nombre est passé à 115. Et pour la seule année 1988, il y en a eu 86, soit 22 % des demandes annuelles d'évaluation des risques pour la santé1. Au cours des années 1980, la "pollution intérieure" est devenue un objet d'activisme, d'enquête et de réglementation possible, subtilement lié à un mouvement croissant visant à réglementer la consommation publique de tabac. En 1984, le Congrès a ajouté la recherche sur la pollution intérieure au mandat de l'EPA (Environmental Protection Agency), qui se montrait réticente, en ajoutant un poste au budget de l'agence. De 1987 à 1992, la lutte contre la pollution intérieure, défendue par le député écologiste Joseph Kennedy (D-R.I.), a fait l'objet d'auditions au Congrès sur une proposition de loi relative à la qualité de l'air intérieur (Indoor Air Quality Act). Le rapport du Congrès citait la déclaration du directeur de la Consumer Federation of America selon laquelle la pollution intérieure était "la première menace cachée pour la santé"2. En 1988, Philip Morris, R. J. Reynolds Tobacco Company, Lorillard Corporation, Svenska Tobaks ab et Brown Williamson Tobacco Corporation ont fondé ensemble le Center for Indoor Air Research (CIAR), une organisation à but non lucratif, qui est rapidement devenue la plus grande source non gouvernementale de financement de la recherche sur la pollution de l'air intérieur, en soutenant à la fois des scientifiques réputé·es dans de grandes universités et des recherches soutenues par l'industrie sur les effets du tabagisme passif3. Alors que la plupart des immeubles de bureaux étaient devenus des espaces non-fumeurs au cours des années 1980, les fabricants de tabac espéraient que la pléthore de produits contribuant à la pollution intérieure contribuerait à détourner l'attention des cigarettes. L'attention portée à l'air intérieur ayant augmenté, les demandes d'enquêtes du NIOSH sur les immeubles de bureaux ont atteint le chiffre record de 814 pour la seule année 1993, soit 71 % de l'ensemble des demandes adressées au NIOSH4.
Les expositions chimiques étaient, et sont toujours, notoirement difficiles à prouver. Elles sont composées de molécules invisibles à l'œil nu (voire au nez) et ne sont généralement étudiées que bien après le moment initial de leur présence. Dans les débats sur les incidents liés à l'exposition aux produits chimiques, la difficulté de prouver objectivement que la molécule errante A, libérée au moment B, a provoqué les symptômes x, y et z a fréquemment jeté le doute sur la réalité même de l'exposition. Dans les années 1980, l'incertitude liée à l'exposition aux produits chimiques a embourbé les bureaux dans des plaintes relatives à la santé au travail. Lorsque les hygiénistes industriel·les du gouvernement sont venu·es enquêter dans les immeubles de bureaux, leurs échantillonneurs d'air ont rarement détecté une présence chimique significative susceptible d'expliquer la multiplicité des symptômes dont se plaignaient les travailleur·euses, des infections des sinus aux éruptions cutanées en passant par les maux de tête.
La notion de syndrome du bâtiment malsain (SBM) a été utilisée pour la première fois en 1984 par un biophysicien de Yale d'origine danoise dans une publication suédoise et s'est rapidement répandue dans la littérature médicale de langue anglaise et dans les comptes rendus des médias sur les immeubles de bureaux à problèmes des deux côtés de l'Atlantique5. Le nom a immédiatement suscité la controverse : comment un immeuble pouvait-il être qualifié de "malsain" ?6 De plus, les événements décrits par le SBM étaient eux-mêmes étranges dans leur forme : des expositions chimiques imperceptibles combinées à des symptômes multiples. Peut-on prouver que de tels événements sont réels ? Les bureaux, les maisons, les écoles et les centres commerciaux - des espaces auparavant considérés comme des abris contre le danger - étaient-ils pollués ?
Les enquêteur·ices du NIOSH et d'autres chercheur·euses sur la pollution intérieure se sont divisé·es en deux camps, l'un soutenant que la pollution intérieure existait sous des formes chroniques et non spécifiques et que le syndrome du bâtiment malsain était un réel phénomène, l'autre soutenant que le syndrome du bâtiment malsain était une appellation fallacieuse pour désigner ce qui relevait d'un délire psychologique genré.
Ce chapitre compare deux manières différentes, historiquement spécifiques, dont les scientifiques et les travailleur·euses ont matérialisé les expositions chimiques en tant qu'événements perceptibles, mais néanmoins incertains et presque impossibles à prouver. Au cours du vingtième siècle, deux traditions distinctes, deux régimes de perceptibilité distincts, que j'appellerai la toxicologie et l'épidémiologie populaire, ont caractérisé les effets des bâtiments sur les corps de manière contradictoire. Je soutiens que le syndrome du bâtiment malsain est né, sous sa forme incertaine et non spécifique, à la convergence de ces deux manières différentes d'appréhender l'exposition aux produits chimiques. La toxicologie et l'épidémiologie populaire dépendaient d'assemblages différents pour percevoir les expositions, invoquant ainsi des termes divergents pour leur existence.
Comme dans le cas de la ventilation (Chapitre 1), les assemblages qui régissent la toxicologie et l'épidémiologie populaire sont à la fois productifs et contraignants. Chacun permettait d'appréhender certaines qualités, certains attributs et certaines connexions, mais pas d'autres. Chacun des deux assemblages que je retrace impliquait un désengagement d'un champ plus large de possibilités dans le but de se concentrer, d'isoler et de rendre intelligible un ensemble plus étroitement délimité de qualités. En outre, ces deux assemblages étaient imprégnés de relations de genre et de privilèges. Tout au long du XXe siècle, des militantes féministes, des enquêteur·ices et même des bureaucrates ont attiré l'attention sur les questions de santé au travail, tandis que les travailleuses blanches ont été mises au premier plan pour être secourues et protégées7. Les performances de genre ont influencé les technologies, les pratiques et les positions des sujets qui composaient l'hygiène industrielle et l'épidémiologie populaire. L'enjeu des luttes visant à rendre les expositions chimiques perceptibles n'était pas seulement de savoir comment observer les molécules errantes, mais aussi de savoir qui avait la légitimité d’observer et qui subissait les expositions.
Toxicologie, hygiène industrielle et spécificité
Solvants. Hydrocarbures aromatiques polycycliques. Dibromochloropropane. Chlorure de vinyle. Acrylamide. Diisocyanate de toluène. Disulfure de carbone. Pentachlorophénol. Oxyde d'éthylène
- Table des matières, dans Zenz, Médecine du travail
Ouvrez un manuel de médecine du travail datant de la fin du XXe siècle et la table des matières ressemblera probablement à une liste de produits chimiques8.
Chaque produit chimique a une valeur seuil à partir de laquelle il devient toxique et une description des effets provoqués dans le corps humain une fois ce seuil dépassé. Il n'y a pas de portrait de l'atelier ou des conditions de travail. Il n'y a pas de récits de difficultés familiales. Ces descriptions sont rédigées dans un langage spécialisé provenant des laboratoires, où les techniques de toxicologie ont rendu les produits chimiques industriels mesurables. Ouvrons les portes de la toxicologie pour découvrir comment elle a relié les produits chimiques aux corps.
Dès le XVIIIe siècle, avec les travaux du chimiste français Antoine-Laurent Lavoisier, les scientifiques ont compris que l'air était ordinairement composé d'oxygène et de dioxyde de carbone9. Au début du XXe siècle, des ingénieurs en ventilation américains avaient conclu que les composants chimiques de l'air ordinaire n'avaient guère d'importance pour le confort ou la santé de l'homme dans les immeubles de bureaux. Les hygiénistes industriel·les, en revanche, s'intéressaient aux substances chimiques dangereuses présentes dans l'atmosphère des usines10. En d'autres termes, iels s'intéressaient aux substances chimiques émanant du paysage industriel qui n'étaient pas naturelles pour l'air.
Alice Hamilton, l'une des fondatrices les plus influentes de l'hygiène industrielle américaine, était à cheval sur les mondes sociaux des laboratoires et des mouvements de réforme de l'ère progressiste11. Hamilton, médecin ayant suivi une formation avancée en bactériologie et en pathologie, a rejoint l'établissement Hull House de Jane Addams à Chicago, au sein duquel des femmes professionnelles de classe moyenne, souvent féministes, vivaient parmi les pauvres, en particulier immigré·es, les étudiaient et les aidaient12. Au lieu de s'appuyer sur la rhétorique et les stratégies des syndicats, les femmes réformatrices de la classe moyenne blanche ont mobilisé le maternalisme pour appeler à la protection des femmes d'origine essentiellement européenne. En plaidant pour une législation protectionniste, elles ont stratégiquement affirmé que les femmes possédaient des faiblesses biologiques spécifiques à leur sexe qui nécessitaient un traitement spécial. En outre, elles soutenaient que le double rôle des femmes en tant que travailleuses et mères impliquait que les produits chimiques industriels n'étaient pas simplement des poisons potentiels, mais aussi ce que Hamilton appelait des "poisons raciaux"13. Dès le début de l'hygiène industrielle américaine, le genre et la race des travailleur·euses ont été des considérations importantes.
Les stratégies protectionnistes maternalistes sont nées de ce que l'historienne Allison Hepler a appelé la "vision du monde environnementaliste" du début du vingtième siècle, en vertu de laquelle, premièrement, la maladie était causée par les conditions environnementales et, deuxièmement, les conditions des lieux de travail pouvaient être transportées à la maison, non pas par des produits chimiques s'accrochant aux vêtements, mais plutôt en entravant l'important travail de reproduction des femmes pour la famille, la société et la race. Le protectionnisme, ont souligné les promoteur·ices du Equal Rights Amendment, pouvait fonctionner comme une diversion pour ''protéger'' les femmes des emplois mieux rémunérés des travailleurs syndiqués masculins14.
Bien que Hamilton ait utilisé certaines méthodes de laboratoire dans ses enquêtes, celles-ci ne constituaient qu'un outil parmi d'autres dans son large éventail de techniques. Elle s'est principalement appuyée sur des inspections d'usines et des enquêtes auprès des employé·es et des clinicien·nes locale·aux15. Utilisant la méthodologie des sciences sociales pratiquée à Hull House, elle a enquêté sur les lieux de travail et a méticuleusement interrogé les travailleur·euses à leur domicile, apprenant leurs symptômes, mesurant les niveaux de plomb sur leurs vêtements et dans leurs cuisines, et les convainquant de révéler comment la direction pouvait faire obstruction à son enquête. C'est sur les connaissances des travailleur·euses, des contremaîtres et des médecins de quartier, acquises au cours d'années de travail au sein du process industriel, que Hamilton s'est appuyée pour ses inspections et ses enquêtes. On peut donc dire que son succès est davantage dû à sa force de persuasion personnelle et à sa capacité à dresser des portraits déchirants de la vie en usine qu'à l'objectivité de la science qu'elle maniait.
Si l'idée que le gouvernement devrait fournir des informations sur la sécurité des produits chimiques utilisés sur le lieu de travail est née à l'ère progressiste, ce n'est que dans l'entre-deux-guerres que l'assemblage de technologies, de personnes et de pratiques qui a donné forme à la toxicologie réglementaire contemporaine a été formulé pour la première fois16. Avec la "panique rouge" qui a immédiatement suivi la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, les politiques réformistes et radicales de l'ère progressiste ont été sévèrement réprimées. La montée du patriotisme conservateur s'est accompagnée d'une répression violente des grèves et de l'expulsion des radicale·ux né·es à l'étranger. Dans ce contexte répressif du début des années 1920, les syndicats ont perdu de leur force, tout comme l'agitation progressiste et radicale autour de la santé au travail. C'est également à cette époque que l'hygiène industrielle scientifique prend pied dans les institutions avec la création de laboratoires universitaires. Dans des écoles prestigieuses telles que Harvard, Yale, Johns Hopkins, Columbia et l'université de Pennsylvanie, les laboratoires d'hygiène industrielle offraient une alternative aux tentatives antérieures de la santé publique de contrôler les maladies professionnelles par le biais d'enquêtes, d'inspections, de législations et d'examens physiques17. Contrairement aux efforts de Hamilton pour politiser son travail scientifique, les laboratoires d'hygiène industrielle de l'entre-deux-guerres proposaient leurs services toxicologiques et physiologiques aux entreprises comme un moyen objectif, apolitique et non législatif d'arbitrer les litiges relatifs aux maladies professionnelles18.
Naïvement, peut-être, certain·es hygiénistes industriel·les universitaires s'attendaient à ce que l'entreprise moderne mette en pratique les connaissances acquises dans les laboratoires universitaires sans législation, simplement parce que c'était bon pour les affaires. Iels firent appel aux entreprises pour obtenir des financements, se présentant comme n'étant ni pro-travailleur·euses ni pro-industrie, mais comme un ensemble d'expert·es indépendant·es capables de régler les conflits du travail sur la santé professionnelle de manière équitable et sans recourir à la politique. Comme l'a montré l'historien Christopher Sellers, leur pouvoir professionnel et leur "indépendance" politique reposaient sur le passage du terrain au laboratoire et de l'homme à l'animal, ce qui a contribué à dépolitiser leur science19. Au sein du laboratoire, le succès dépendait de leur capacité technique à percevoir ce qui était invisible pour les clinicien·nes ou les travailleur·euses : la chaîne spécifique d'effets qu'un produit chimique provoquait systématiquement dans la physiologie humaine. Autrement dit, en faisant passer le lien entre les produits chimiques et les corps par le laboratoire, l'hygiène industrielle promettait d'objectiver la causalité des maladies industrielles.
La section d'hygiène industrielle de Harvard, fondée en 1918, a été l'un des sites les plus importants où s'est déroulé l’élaboration de l'hygiène industrielle. En 1919, Hamilton rejoint la faculté de Harvard, qui comprend des scientifiques de renom tels que Cecil Drinker, un médecin devenu physiologiste qui dirige le nouveau programme de recherche sur l'hygiène industrielle, et Joseph Aub, connu pour ses recherches médicales sur le cancer, le métabolisme et la toxicologie. La chimie des maladies était au cœur des recherches menées à Harvard, sous l'influence du chimiste physiologiste Lawrence J. Henderson, connu pour ses études révolutionnaires sur la chimie du sang, et de l'influent physiologiste Walter Cannon, qui étudiait la physiologie en termes de régulation chimique et de déséquilibres. La carrière de Henderson est révélatrice de l'éventail des sympathies de l'hygiène industrielle de Harvard : outre ses travaux sur la chimie, il était associé à la Harvard Business School, appliquant les connaissances qu'il avait acquises en physiologie aux théories du management20.
Comment la toxicologie a-t-elle fait le lien entre les environnements de travail et les corps des travailleur·euses ? Les hygiénistes industriel, avec l'aide de leurs collègues physiologistes, ont abordé le corps humain, sans surprise, sous l'angle de la chimie et de la réglementation des produits chimiques. Iels ont mis au point des techniques permettant de détecter de petites quantités d'une substance dans le sang et ont eu recours à l'expérimentation animale pour trouver le mécanisme physiochimique susceptible d'expliquer les pathologies correspondantes. La recherche sur le saturnisme menée à Harvard en est l'exemple emblématique : les hygiénistes industriel ont pu détecter le plomb dans l'atmosphère, puis dans le sang et les tissus, et enfin retracer l'ensemble spécifique de changements physiochimiques que le plomb provoquait habituellement dans l'organisme21.
Au cœur de ce domaine émergent de la toxicologie se trouvaient, premièrement, des techniques de physiologie expérimentale pouvant être pratiquées sur des animaux ; deuxièmement, des instruments mesurant les processus physiologiques, les rendant quantitatifs, standardisés et donc comparables ; et troisièmement, la chambre d'exposition, une technologie importée de la recherche sur les techniques de ventilation. La recherche sur la ventilation faisait partie intégrante de la section d'hygiène industrielle de Harvard, au même titre que la toxicologie. Cecil Drinker a engagé son frère Philip Drinker, ingénieur impliqué dans la recherche sur la ventilation à l'Ashve et inventeur du poumon d'acier, pour concevoir une chambre environnementale à utiliser dans les expériences d'exposition aux produits chimiques, semblable à la chambre qu'il a construite avec Constantine Yaglou, également membre de la faculté dans cette section, pour l'utilisation dans la recherche sur la zone de confort. Au lieu d'utiliser la chambre hermétique pour jouer avec les variables climatiques, les hygiénistes industriel ont introduit un produit chimique spécifique à une concentration contrôlée et ont mesuré ses effets sur leurs sujets d'expérience (voir Fig. 16). À Harvard, les composés étudiés comprenaient le benzène, le manganèse, le plomb, le radium, le monoxyde de carbone et les vapeurs d'acide sulfurique. En 1938, l'American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) a créé un comité chargé d'élaborer des normes de sécurité pour les produits chimiques industriels22. En 1946, il a publié sa première liste de ce qui était alors appelé "concentrations maximales admissibles" (MACS - Maximum Allowable Concentrations), et réorganisé en 1956 sous le nom de "valeurs limites de seuil" (TLVS - Threshold Limit Values). Ce changement n'était pas simplement technique, il s'agissait aussi de s'éloigner de l'usage russe des MACS à une époque radicalement anticommuniste23.
Le premier régime de perception du récit de ce chapitre était basé sur un assemblage matériel inscrit dans les outils et les pratiques de l'hygiène industrielle en laboratoire et représenté visuellement par la "courbe dose-réponse" utilisée pour déterminer une TLSV24 [valeur limite d'exposition Ndt]. Ici, lorsqu'un corps était placé dans la "boîte vide" de la chambre environnementale, il ne s'agissait pas du corps d'un homme blanc, mais plutôt d'un lapin, d'un rat ou, plus typiquement, d'une souris blanche produite en masse, élevée pour sa capacité à réagir aux produits chimiques de manière prévisible.
Il n'y avait pas qu'une seule boîte, mais plusieurs, chacune contenant un groupe d'environ cinquante animaux, qui étaient exposés à une dose différente et assez élevée d'un produit chimique pendant environ un tiers de leur vie, ce qui correspond à quelques mois pour les souris25. Les toxicologues ont ensuite détecté les changements physiologiques qui étaient, premièrement, discernables avec les tests de diagnostic disponibles (bien sûr, les souris ne peuvent pas parler pour elles-mêmes), et, deuxièmement, suffisamment réguliers pour se produire de nombreuses fois dans un petit groupe de seulement cinquante animaux. Le nombre d'animaux de chaque boîte présentant des effets sur la santé a ensuite été représenté sur un graphique en fonction de la concentration de l'exposition chimique.
C'est ainsi qu'est née la courbe dose-réponse. Chaque produit chimique avait sa propre courbe, mais les courbes dose-réponse avaient en général une forme particulière. Étant donné les concentrations chimiques relativement élevées utilisées par les chercheur·euses pour induire des effets significatifs sur la santé, la courbe a dû être extrapolée mathématiquement vers le bas pour des concentrations plus faibles, ce qui a permis aux scientifiques de prédire la concentration à laquelle aucun effet sur la santé ne serait provoqué. La concentration chimique à ce point du graphique était alors divisée par cent, pour une marge de sécurité supplémentaire, et appelée "valeur limite de seuil" pour les travailleur·euses humain·es exposé·es quotidiennement à ce produit chimique au travail cinq jours par semaine, huit heures par jour. Ces expériences toxicologiques visaient uniquement à matérialiser les réactions physiologiques aux produits chimiques qui étaient à la fois régulières - c'est-à-dire reproductibles - et spécifiques - c'est-à-dire une réaction physiologique caractéristique de ce produit chimique. De même, les corps ont été étudiés en tant qu'objets réagissant de manière spécifique, prévisible et cohérente aux produits chimiques.
Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, avec l'affaiblissement du mouvement ouvrier industriel, la médecine du travail a perdu de son prestige. Dans l'après-guerre, la toxicologie est devenue une spécialité indépendante, ses techniques et ses outils s'éloignant des maladies professionnelles pour s'orienter vers des études plus générales sur les produits chimiques, telles que les tests sur les produits de consommation et les pesticides. Les laboratoires de toxicologie n'étaient plus dirigés par des physiologistes célèbres ou situés dans des universités prestigieuses. Ils se sont étendus à des bureaucraties telles que la Food and Drug Administration (FDA) et à des laboratoires de recherche privés qui sont devenus des éléments importants des grandes entreprises américaines dans les années 1950 et 196026. Les entreprises ne s'appuyaient plus sur l'expertise des hygiénistes industriel universitaires, mais testaient leurs produits chimiques en interne, garantissant ainsi un meilleur contrôle des méthodes et des résultats. L'ACGIH a commencé à publier sa liste de TLVS sous forme de normes volontaires en 1962 et a depuis publié sept éditions couvrant 642 substances (seulement une petite fraction des ingrédients chimiques utilisés dans le secteur industriel). La détermination des TLVS était coûteuse et prenait beaucoup de temps. La plupart des TLVS étaient basées sur des recommandations faites par les représentant·es des entreprises chimiques et industrielles plutôt que sur des recherches publiées ou évaluées par des pairs. Les TLVS publiées étaient souvent fondées non pas sur des données scientifiques réelles, mais sur un "consensus" entre les membres du comité, qui comprenait des toxicologues de DuPont, Dow, Bayer et d'autres fabricants de produits chimiques, ainsi que des fabricants d'équipements27. Un des premiers présidents du comité des limites de seuil de l'ACGIH, Lawrence Fair Hill, a candidement révélé que le comité recherchait « des valeurs qui, d'une part, protègent les travailleur·euses individuel et, d'autre part, n'imposent pas de charge impossible au fabricant »28. Le point qui me semble important, cependant, ce n'est pas que la recherche qui sous-tend les TLVS était suspecte, bâclée et d'origine corporative (ce qu'elle était souvent), mais plutôt que même dans sa forme la plus rigoureuse, cette méthode était très limitée dans ce qu'elle pouvait faire et percevoir.
Cet assemblage pour matérialiser les effets des produits chimiques sur les corps a connu un grand succès, d’où l'association réussie du plomb au saturnisme, du silicium à la silicose, de l'amiante à l'asbestose29. Des années 1930 aux années 1960, des maladies spécifiques telles que la silicose ont été ajoutées progressivement aux barèmes d'indemnisation des travailleur·euses des États. L'hygiène industrielle, à son tour, a construit des instruments à utiliser sur le terrain - tels que des échantillonneurs d'air et des tests sanguins - afin d'enregistrer les niveaux aigus de produits chimiques connus en milieu industriel et leur réaction physiologique caractéristique. Lorsque les commissions d'indemnisation des accidents du travail et les tribunaux ont tenté de trancher les litiges relatifs à l'exposition aux produits chimiques, ils ont également utilisé les normes de preuve établies par la toxicologie30. Lentement, par incrémentations sporadiques, les programmes d'indemnisation des États ont couvert toutes les maladies professionnelles discrètes pour lesquelles les demandeurs pouvaient démontrer (1) une exposition à un produit chimique spécifique, (2) des symptômes liés à l'exposition à ce produit chimique et (3) un test sanguin, une radiographie ou un autre test de diagnostic standardisé qui démontrait objectivement un effet physiologique typique de ce produit chimique. Les expositions aux produits chimiques, si elles remplissaient ce cahier des charges, se voyaient reconnaître une existence dans les domaines juridique et médical. Les travailleur·euses cherchant à obtenir une indemnisation dépendaient donc d'expert·es pour matérialiser l'effet des produits chimiques sur leur corps.
Ce régime a également créé un champ de non perception. Si la toxicologie a sans aucun doute réussi à rendre perceptibles certains types de maladies professionnelles, elle a en même temps donné une définition restrictive de ce qu'est une exposition chimique significative, créant ainsi un champ de non perception dans lequel s'inscrivaient d'autres réactions. Les réactions à des combinaisons de produits chimiques ou à des expositions chroniques de faible niveau, ainsi que les réactions rares ou variables, échappaient toutes aux pratiques de la toxicologie et de l'hygiène industrielle. L'assemblage dominant en toxicologie ne rendait pas seulement perceptibles les effets corporels spécifiques des produits chimiques, il établissait également des critères permettant d'exclure un état corporel de la catégorie des maladies professionnelles. Alors que la silicose pouvait être identifiée par des radiographies et le saturnisme par des analyses de sang, d'autres maladies professionnelles n'entraient pas aussi facilement dans les tests diagnostic31. Lorsque les symptômes des travailleur·euses n'entraient pas dans ce moule, les entreprises et les régimes d'indemnisation pouvaient affirmer de manière convaincante qu'il n'existait pas de maladie professionnelle ou, du moins, que l'indemnisation financière n'était pas justifiée. L'absence de recherche sur une maladie particulière, une mauvaise adéquation avec les tests de diagnostic approuvés ou des effets à long terme qui ne se prêtaient pas aux méthodes toxicologiques pouvaient faire en sorte qu'une maladie professionnelle ne soit pas indemnisée et qu'elle soit rendue imperceptible. En d'autres termes, l'absence de spécificité pouvait être utilisée pour prétendre à l'inexistence. Les expositions de faible niveau et les expositions mixtes sont devenues de facto des phénomènes incertains.
Fondé en 1971, le National Institute for Occupational Safety and Health (niosh), dont la mission est de rechercher et d'enquêter sur la sécurité et la santé au travail, et l'Osha, l'agence fédérale chargée de réglementer la sécurité des lieux de travail, ont rapidement et sans esprit critique adopté les TLV comme normes officielles pour l'air sur les lieux de travail. Lorsque le NIOSH a enquêté sur des immeubles de bureaux, ses méthodes et outils, conçus pour des environnements industriels, n'ont pu que reproduire ce champ de non perception32. Les échantillonneurs d'air industriels n'ont presque jamais réussi à percevoir le moindre signe d'exposition chimique aiguë, et les enquêteur·ices n'ont pu que constater une multitude de symptômes apparemment sans rapport les uns avec les autres. Les recherches publiées sur les bâtiments malades déplorent les difficultés à détecter les expositions : ''les vastes programmes d'échantillonnage de l'air dans un certain nombre d'enquêtes sur les bâtiments étanches n'ont pas encore permis de détecter des contaminants de l'air à des concentrations dépassant, ou même approchant, une quelconque valeur limite d'exposition'33'. La plupart des chercheur·euses se sont rabattus sur une mauvaise ventilation comme explication globale. Même les recherches épidémiologiques portant sur des échantillons et des contrôles importants n'ont pas permis de trouver un agent chimique spécifique, mais seulement des taux de ventilation réduits dans des bâtiments aux fenêtres scellées34.
En l'absence d'expositions chimiques discernables et de maladies distinctes, les enquêteur·ices du NIOSH ont eu du mal à affirmer qu'il se passait quelque chose de physique dans les épidémies survenues dans les bureaux. Comment expliquer alors les plaintes relatives à l'exposition aux produits chimiques ?
Le genre de l'inexistence
Les psychologues du NIOSH et d'autres organismes ont commencé à suggérer que ces incidents étaient peut-être une forme de maladie psychogène de masse (MPI - Mass Psychogenic Disease), également connue sous le nom d'hystérie de masse35. La MPI était considérée comme une pathologie de la perception, une forme de perception erronée dans laquelle les travailleur·euses attribuaient à tort leurs symptômes à leur lieu de travail physique, alors que les symptômes avaient en réalité une origine psychologique. Les critères de la MPI, fondés sur l'entrée "trouble psychosomatique" du Manuel diagnostique et statistique, étaient techniquement un diagnostic par exclusion : "l'apparition collective de symptômes physiques et de croyances connexes chez deux personnes ou plus en l'absence d'un agent pathogène identifiable", ce qui impliquait que les symptômes étaient "induits par l'anxiété ou le stress"36.
En outre, le diagnostic a été appliqué exclusivement à des manifestations de maladies chez les femmes - dans les écoles de filles, les clubs de femmes et les lieux de travail séparés, en particulier chez les jeunes femmes travaillant sur les chaînes d'assemblage électronique en Asie du Sud-Est. Ce n'est que dans les années 1990 que le diagnostic a été étendu aux hommes invoquant le syndrome de la guerre du Golfe. Une étude des cas américains publiés de maladies psychogènes de masse, réalisée par deux psychologues du NIOSH, a révélé que 93 % des personnes diagnostiquées étaient des femmes, décrivant cette dimension genrée comme la "caractéristique la plus évidente" du diagnostic37. Peter Boxer, médecin et professeur de psychiatrie à l'université de Cincinnati, a également considéré que l'attribut déterminant des cas de MPI était la présence de "femmes relativement peu éduquées, faiblement rémunérées et effectuant des tâches très routinières"38. Michael Colligan, psychologue au NIOSH et promoteur du diagnostic de la MPI, n'était pas le seul à suggérer que la dimension genrée de la MPI était liée à la nature plus "émotionnelle" des femmes ou aux tensions entre le travail et la famille39. D'autres partisan·nes de la MPI sont allé·es jusqu'à suggérer que la MPI était le résultat de cet "événement exclusivement féminin qu'est le cycle menstruel"40. Cette affirmation tacite était courante dans les pages du Journal for Occupational Medicine au cours des années 1960, où les publicités pour les tranquillisants ciblaient le traitement des patientes gênantes qui ne voulaient pas avouer la nature menstruelle de leurs problèmes. La publicité pour le diurétique et tranquillisant Cyclex, dont le nom même évoque les menstruations, recommandait aux médecins de ne pas compter sur les patientes pour avouer la véritable nature menstruelle de leurs problèmes. Cette publicité montrait clairement que l'on ne pouvait pas faire confiance aux femmes pour signaler ou même évaluer la véritable nature de leur mauvaise santé. Lorsqu'il s'agit d'expliquer l'imperceptibilité d'une cause physique, les corps qui travaillent dans les immeubles de bureaux deviennent non seulement humains, mais aussi féminins.
Le diagnostic de MPI a rarement été accepté par les employées de bureau. Un promoteur du diagnostic a observé que "les personnes souffrant de maladies psychogènes s'accrochent souvent avec ténacité à l'idée que leur maladie est ‘purement physique’". Cela ne l'a toutefois pas empêché d'appliquer le diagnostic à un incident dans lequel "pas une seule employée ne pensait que des facteurs psychologiques avaient joué un rôle important"41. Le diagnostic de la MPI repose sur l'hypothèse non dissimulée selon laquelle les femmes ne sont pas dignes de confiance pour témoigner des événements qui se produisent dans leur propre corps. Les psychologues du NIOSH estiment que "dans la mesure où l'individu est capable d'attribuer avec précision les malaises existants à des facteurs de stress liés à la vie et au travail, la susceptibilité à la maladie psychogène de masse devrait diminuer"42. Considérés comme échappant à la détection physique par un régime d'appréhension des expositions chimiques matériellement intégré dans les instruments et les méthodes de l'hygiène industrielle, les épisodes de maladies professionnelles dans les bureaux ont très souvent été qualifiés de pathologie troublante de la perception, sans lien avec des questions concrètes d'environnement. Face à l'échec de la toxicologie et aux accusations d'hystérie, de quels moyens disposaient les travailleur·euses désireu·ses de faire valoir la présence et la nature des expositions chimiques au vingtième siècle ?
Épidémiologie populaire et distribution des maladies
Votre bureau est-il trop chaud, trop froid, plein de courants d'air, poussiéreux ?
L'apport d'air est-il bon, insuffisant, pas d'air frais du tout ?
La circulation de l'air est-elle bonne, insuffisante, pas de circulation du tout ?
Y a-t-il des fumées irritantes dans l'air ? oui non
Si oui, d'où viennent-elles ?
- Enquête sur la santé et la sécurité des employés de bureau, 1981J'ai sorti notre carnet d'enquête sur la santé et j'ai commencé à placer des carrés, des triangles et des étoiles sur une carte des rues, avec un symbole différent pour chaque groupe de maladies. [...] Soudain, un modèle est apparu !
- Gibbs, Love Canal (1982), 66-67
Comment un·e travailleur·euse peut-iel deviner qu'une molécule errante de ce morceau de moquette s'est retrouvée dans ses poumons et qu'il s'agit de l'irritant spécifique à l'origine de son mal de tête, de son infection ou de sa tumeur ? La toxicologie, bien qu'elle soit une preuve nécessaire pour les salles d'audience, n'a pas été le seul moyen utilisé à grande échelle pour identifier les environnements dangereux. Les enquêtes, comme celles menées par le mouvement des femmes employées de bureau, constituaient une autre méthode pour rendre compte de l'exposition aux produits chimiques, non pas au niveau de l'individu, mais à l'échelle de la communauté, du quartier ou de l'immeuble. La tradition des enquêtes menées par des non-scientifiques qui ont dressé la carte des environnements dégradés et insalubres est vieille d'au moins un siècle.
Le sociologue Phil Brown a inventé le terme d'épidémiologie populaire en 1987 pour décrire comment des femmes de la classe ouvrière comme Lois Gibbs et Ann Anderson allaient de maison en maison pour enquêter sur l'incidence des maladies familiales dans leurs quartiers de Love Canal, à New York, et de Woburn, dans le Massachusetts, dans les années 197043. Depuis, les chercheur·euses ont désigné l'épidémiologie populaire comme la pierre angulaire de l'activisme communautaire contemporain en matière d'environnement44. L'épidémiologie populaire est la pratique par laquelle les profanes, les militant·es et les scientifiques sympathisant·es recueillent et organisent des informations empiriques pour identifier les problèmes de santé là où iels vivent ou travaillent. Également appelée épidémiologie de bon sens, épidémiologie de rue ou épidémiologie de la « ménagère », elle a permis d'identifier la plupart des cas d'exposition communautaire à des substances toxiques ainsi que des clusters de cancers sur des lieux de travail dans l'Amérique de la fin du vingtième siècle45.
Découvrons l'épidémiologie populaire de la fin du vingtième siècle. Elle se compose d'un ensemble d'outils, de pratiques et de positions très différentes de celles de la toxicologie. Alors que la toxicologie saisissait et donnait un sens à l'exposition aux produits chimiques dans les laboratoires, où les scientifiques isolaient les effets physiologiques caractéristiques d'un produit chimique dans des conditions expérimentales hautement contrôlées, l'épidémiologie populaire, en revanche, se déroulait sur le terrain, où les populations locales cartographiaient la distribution d'un problème de santé et sa proximité spatiale avec l'industrie et les panaches ou les odeurs qui y sont associés. Alors que la toxicologie objectivait des produits chimiques spécifiques, l'épidémiologie populaire cartographiait la santé en fonction de la distribution sociale et spatiale des différences dans l'environnement bâti. Alors que la toxicologie considérait les corps comme prévisibles et universalisables, l'épidémiologie populaire permettait aux corps d'être divers dans leur réaction à un environnement commun.
Le mouvement des femmes employées de bureau a suivi les traces des militant·es contre les déchets toxiques lorsqu'il a commencé à utiliser des enquêtes pour recueillir des plaintes sanitaires à grande échelle dans les immeubles de bureaux au début des années 1980. Les éléments de cet assemblage trouvent toutefois leur origine dans le mouvement des enquêtes sociales de l'ère progressiste. Les enquêtes sociales étaient une tradition de collecte de données descriptives par des activistes, des habitant·es, des chercheur·euses en sciences sociales marginale·aux et des organisations caritatives, pratiquée pour la première fois dans les années 1880, avant que la discipline de la sociologie ne s’établissent dans les universités américaines46. Les premières enquêtes sociales aux États-Unis ont vu le jour dans les maisons d'accueil, qui mettaient en avant le rôle des connaissances dans le travail de réforme sociale. La connaissance provenait de deux activités : l'expérience personnelle de la vie au sein d'une communauté pauvre et les enquêtes empiriques, intimes, maison par maison. Résider dans une maison d'accueil était censé favoriser l'empathie ; un·e réformateur·ice devait "être comme une voisine parmi les voisin·es ; entendre jour après jour les ragots répétitifs et terribles de la rue ; prendre, comme on en vient insensiblement à le faire, le point de vue sur les questions morales et physiques de personnes qui dorment à sept dans une pièce"47. Tout en vivant au milieu de la classe ouvrière et des pauvres qu'iels cherchaient à servir par leurs bonnes œuvres, les réformateur·ices des maisons d'accueil ont "américanisé" les nouveaux immigrant·es, dispensé des cours d'alphabétisation, d'art et de cuisine et fourni des services de garderie, de loisirs et de santé publique aux familles locales. Inspiré par l'enquête de Charles Booth, Life and Labor in London (1899-1903), le mouvement américain des enquêtes sociales a pratiqué l’enquête de première main sur les conditions de vie d'une communauté afin de formuler des programmes d'amélioration, partageant une foi positiviste dans la capacité de la science à provoquer des changements sociaux.
The Philadelphia Negro (1899) de W. E. B. DuBois, inspiré par l'étude de Booth, fut l'une des premières enquêtes sociales publiées en Amérique48. Financée par le Quaker Philadelphia Settlement, l'étude visait à ''présenter au public un ensemble d'informations'' permettant de trouver une solution au ''problème noir'' dans le septième arrondissement49. À l'instar des enquêteur·ices sociale·aux qui allaient suivre, DuBois et ses assistant·es sont allé·es de maison en maison avec une série de questionnaires interrogeant les habitant·es sur tous les sujets, de leur lieu de résidence à leur éducation, en passant par leurs occupations, leur santé, la criminalité, le paupérisme, les relations sociales et la vie de famille. Le troisième des six questionnaires utilisés portait sur "l'environnement des Noir·es" et posait des questions sur le logement, la promiscuité, les cours, l'hygiène, les toilettes, les fenêtres, le lavage, l'aération, la lumière et la propreté. Les résultats furent classés dans des chapitres détaillés, des tableaux quantitatifs simples et des cartes à l'échelle de la maison (voir Fig. 18). Comme l'a fait valoir l'historienne Mia Bay, DuBois a entrepris The Philadelphia Negro en s'écartant délibérément des méthodes de recherche utilisées par les spécialistes noirs et blancs de la race50. En rassemblant des preuves empiriques, DuBois s'est éloigné des explications raciales en termes de lois naturelles et de la vision des Noir·es comme une masse unique et indifférenciable. L'étude de DuBois visait à "extraire d'une masse complexe de faits les preuves tangibles de l'atmosphère sociale entourant les Noir·es, qui diffère de celle entourant la plupart des Blanc·hes"51 L'objectif était de documenter une "condition et un environnement sociaux" plutôt qu'une condition raciale biologique52. L'enquête de Web DuBois présentait deux qualités typiques des enquêtes sociales : premièrement, une multiplicité ou une diversité d'expressions agrégées et, deuxièmement, des "conditions" plutôt que des causes isolées.
La plupart des maisons d'accueil de l'Est avaient cependant un moins bon bilan en matière de traitement des différences raciales, excluant les Noir·es, organisant des activités ségréguées ou se situant simplement dans des quartiers à majorité blanche53. Les maisons d'accueil ont généralement constitué des opportunités importantes pour les femmes blanches de la classe moyenne qui avaient obtenu un meilleur accès à l'emploi, mais qui n'avaient toujours pas de perspectives d'emploi professionnel. La Hull House de Jane Addams, la plus célèbre des maisons d'accueil et celle dont Alice Hamilton était membre, a également produit une enquête sociale très respectée, The Hull-House Maps and Papers (1895). Florence Kelley, qui a effectué des recherches sur le travail des enfants dans le cadre de cette enquête, est devenue la première femme inspectrice d'usine dans l'Illinois et, plus tard, directrice de la National Consumer League.
Elle a soutenu que de telles démarches en sciences sociales étaient tout particulièrement adaptées aux femmes qui apportaient des préoccupations "humaines" à leur travail54. Comme DuBois, les femmes de Hull House, armées de papier et de crayons, ont consigné des informations détaillées lors d'entretiens maison par maison avec des questionnaires : ''L'enquête a été minutieuse et les faits exposés sont aussi dignes de confiance qu'une enquête personnelle et des efforts intelligents peuvent les rendre. Non seulement chaque maison, chaque appartement et chaque pièce ont été visités et inspectés, mais dans de nombreux cas, les déclarations d'une personne ont été corroborées par beaucoup d'autres, et les déclarations de différent·es travailleur·euses exerçant les mêmes métiers et professions, concernant les salaires et les périodes de chômage, ont servi de confirmation mutuelle55.'' Les mérites et la véracité de l'enquête, selon elles, provenaient de l'attention qu'elle portait à des détails douloureux, une ''plus grande minutie'' qui faisait de la recherche ''une reproduction photographique des quartiers les plus pauvres de Chicago''56. Comme d'autres enquêtes sociales, les recherches de la Hull House ont accordé une attention particulière aux environnements bâtis de la vie et du travail et en ont fait de vibrantes descriptions. L'introduction, destinée à un lectorat de classe moyenne, ne donne qu'une faible idée des chambres sales et des immeubles vétustes, des cours miteuses et des hangars en ruine, des étables infectes et des toilettes extérieures délabrées, des canalisations d'égout brisées et des tas d'ordures qui dégagent des odeurs nauséabondes57. Par le biais de la prose, de statistiques simples et de cartes colorées, les enquêtes fournissaient des témoignages destinés à inciter le public de la classe moyenne à la réforme et l'État à l'intervention. Les femmes réformatrices de l'ère progressiste ont utilisé avec succès les enquêtes sociales pour obtenir l'adoption de lois concernant le plomb sur les lieux de travail ainsi que le travail des enfants.
La position du sujet que les enquêteur·ices ont façonnée dans la pratique des enquêtes sociales diffère nettement de la position détachée et apolitique des toxicologues universitaires et des hygiénistes industriel·les. Exigeant des enquêteur·ices qu'iels vivent dans les communautés qu'iels étudient, les enquêtes sociales expriment un "sentiment géographique" qui cherche à décrire avec empathie les conditions locales58. Selon Florence Kelley, il faut "souffrir des rues sales, de la laideur universelle, du manque d'oxygène dans l'air que l'on respire, de la lutte sans fin contre la suie et la poussière et de l'insuffisance de l'approvisionnement en eau [...] si l'on veut parler comme quelqu'un·e qui a de l'autorité et non comme des scribes sur ces questions de la vie quotidienne et de l'expérience commune"59. De même, DuBois a cherché à étudier le Seventh Ward ''personnellement et non par procuration'' avec ''non pas un manque d'intérêt humain et de conviction morale, mais plutôt avec la qualité de cœur de l'équité.''60 Alors que les femmes de Hull House observaient avec empathie des voisin·es qu'elles considéraient néanmoins comme différent·es d'elles-mêmes, DuBois a mené ses recherches en sciences sociales sur le "problème noir" avec un sens aigu de sa propre identité en tant qu'homme noir. Ses observations ont été enregistrées grâce à une "double conscience, ce sentiment de toujours se regarder à travers les yeux des autres, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui la regarde avec un mépris amusé et de la pitié"61. De plus, les observateur·ices étaient généralement multiples. Bien qu'elles utilisent un questionnaire unique, les enquêtes sociales nécessitent généralement plusieurs enquêteur·ices qui font du porte-à-porte et recueillent des informations auprès d'autant de personnes qu'il y en a dans le quartier. Les enquêtes sociales ne se présentaient donc pas comme une vue représentative ou universalisable, mais comme un réalisme détaillé et empathique, saisi à travers un agrégat de prismes multiples qui cartographiaient la distribution et la diversité des conditions au sein d'une communauté très localisée.
L'enquête sociale la plus complète a été l'enquête de Pittsburgh en six volumes de 1906-1907, entreprise dans le cadre du mouvement de charité62. Financée par la Fondation Russell Sage, l'enquête a été menée par certain·es membres de la classe moyenne de la communauté dans le cadre d'une auto-étude et a été présentée au public comme un moyen de résoudre les problèmes sociaux. Le département des enquêtes et des expositions de la Fondation Russell Sage, ainsi que des organismes civiques locaux, ont financé des milliers d'enquêtes de ce type au cours des années 1940. Le mouvement a atteint son apogée à la fin des années 1920 ; 2 775 enquêtes ont été publiées pour la seule année 192763. Les enquêtes sociales s'inscrivent dans une tradition scientifique réformiste, mais aussi dans une conception de la science ouverte aux amateur·ices et attachée aux communautés plutôt que détachée d'elles. Avec l'établissement de la sociologie académique et la montée de l'enquête par échantillonnage pour le marketing et les sondages, le mouvement des enquêtes sociales a décliné dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale64.
Ce n'est toutefois qu'après la Seconde Guerre mondiale que les épidémiologistes américain·es ont commencé à utiliser des méthodes statistiques complexes pour calculer de manière rigoureuse et analytique les risques relatifs de comportements ou de facteurs spécifiques pour les maladies chroniques. Avec l'arrivée récente des antibiotiques et les gains durement acquis de la réforme de l'assainissement, la démographie des maladies dans l'Amérique du XXe siècle s'est éloignée de celle des maladies infectieuses mortelles qui terrorisaient la vie du XIXe siècle. Le cancer et les maladies cardiaques étaient désormais, sinon plus répandus, du moins des dangers plus visibles. Les grandes études épidémiologiques se sont opposées aux physiologistes expérimentateur·ices pour trouver les causes des maladies cardiaques et du cancer du poumon. Les études épidémiologiques professionnelles ont de plus en plus créé, et pas seulement trouvé, leurs ensembles de données à l'aide d'outils de diagnostic tels que les radiographies, les spiromètres et les numérations de cellules sanguines, dont l'interprétation nécessitait une expertise et des installations techniques. Avec des échantillons et des contrôles de grande taille, ces études pouvaient faire des prédictions probabilistes solides. Dans les années 1970, les maladies cardiaques ont été associées à une alimentation riche en graisses et le cancer du poumon au tabagisme. Des habitudes et des substances qui avaient fait partie de la vie quotidienne de manière courante, sans problème et même avec plaisir, ont été qualifiées de dangereuses.
L'établissement d'un lien entre les comportements et les maladies dépendait de l'éducation du public à la logique épidémiologique. Par le biais de campagnes d'éducation publique, la "nouvelle santé publique" cherchait non seulement à persuader les gens ordinaires de modifier leurs comportements, mais aussi à intérioriser une version populaire du calcul des risques65. Les bon·nes citoyen·nes devaient évaluer leurs propres comportements et modes de vie non seulement sur la base de critères moraux, mais aussi en fonction d'une analyse des risques facilitée par des résultats épidémiologiques vulgarisés. Les dangers pouvaient être trouvés dans la vie quotidienne.
Une fois perçu, le lien entre les produits chimiques industriels et la santé ne pouvait pas être confiné à l'usine, au laboratoire de l'entreprise ou aux cercles scientifiques professionnels. Les travailleur·euses rentraient chez elleux après le travail et remarquaient que leurs maisons se trouvaient sous le panache de l'usine qui les employait, ou que les effluents étaient habituellement déversés dans le fossé au coin de la rue, ou encore que les nouveaux matériaux synthétiques qu'iels consommaient et qui les entouraient étaient fabriqués à partir des mêmes produits chimiques potentiellement dangereux. Après des décennies d'une culture marchande opulente, les dangers des produits chimiques se sont infiltrés hors des usines et dans le désordre de l'imaginaire américain. La présence chimique que l'industrialisation avait produite et qui avait ''ruisselé'' dans la vie quotidienne, selon les termes de Rachel Carson, projetait ''une ombre qui n'est pas moins inquiétante parce qu'elle est informe et obscure.''66 La difficulté de percevoir des expositions chimiques informes et obscures ne les rendait pas moins présentes ou effrayantes pour le public.
Bien qu'elle ait été rendue possible, dans un certain sens, par la vulgarisation du calcul des risques, l'épidémiologie populaire offrait une alternative au format extrêmement ciblé et technique des études médicales. Les outils et les pratiques de l'épidémiologie populaire étaient peu coûteux et facilement disponibles dans la vie quotidienne : un crayon, le téléphone, des carnets de notes, des annonces dans les journaux, des réunions à l'église, du porte-à-porte, des photocopieuses et des cartes publiées. Il serait faux de dire que les épidémiologistes populaires étaient opposé·es à l'utilisation de tests diagnostiques, mais leur méthode de collecte de connaissances intimes et anecdotiques par le biais du porte-à-porte constituait une critique implicite des études étroitement techniques et impersonnelles qui dominaient les enquêtes et les débats scientifiques. Les épidémiologistes populaires n'étaient pas contre la science, mais pour l'accessibilité des connaissances et l'implication de la communauté.
Les femmes des classes populaires et à faibles revenus, et non les réformatrices de la classe moyenne, ont été les principales praticiennes de l'épidémiologie populaire. En tant que cibles fréquentes des campagnes de santé publique et sujets de longue date de la charité de la classe moyenne, les communautés de la classe ouvrière ont eu l'occasion d'observer la science en action et de développer une évaluation critique de la santé publique et de la science financée par l'État ou l'industrie. Les femmes de la classe ouvrière des années 1970 se sont appuyées sur le point de vue intime et géographique de l'enquête sociale et l'ont transformé : elles étaient à la fois les sujets de leurs enquêtes et les enquêtrices. En outre, elles étaient beaucoup plus sceptiques à l'égard de la science que ne l'avaient été les enquêteur·ices sociale·aux et, comme tant d'autres dans les années 1970, elles se méfiaient de l'expertise. La perspective critique à partir de laquelle les épidémiologistes populaires voyaient la science régulatrice en action n'était cependant pas une position antiscientifique, mais la mise en œuvre d'une contre-expertise67. Pour les épidémiologistes populaires, la science n'était pas un arbitre apolitique, mais un outil que les deux parties d'une lutte pouvaient utiliser.
En tant qu'expertes scientifiques autodidactes, les femmes de la classe ouvrière ont étendu la vague de l'activisme ouvrier à la maison et ont répondu à l'appel d'un féminisme renouvelé. Les femmes blanches de la classe ouvrière, en particulier, ont été les premières à créer des groupes d'entraide et des cliniques féministes de santé des femmes, qui encourageaient les femmes à prendre la médecine en main par le biais de l'auto-examen vaginal, de l'extraction menstruelle et de cliniques de santé participatives68. L'épidémiologie populaire était un autre exemple de femmes de la classe ouvrière se présentant comme des contre-experts habilités à utiliser la science. Cependant, les femmes qui se sont retrouvées à mener des enquêtes de voisinage étaient rarement des féministes ; il s'agissait plus généralement de mères devenues activistes au nom de leurs enfants, perpétuant la tradition du réformisme maternaliste69. Ainsi, ces épidémiologistes populaires se sont inspirées des rôles de genre et les ont subvertis en devenant des leaders et des porte-parole de la communauté au nom de la maternité. Bien que les activistes des déchets toxiques ne se soient pas organisé·es en tant que femmes, le Citizens Clearinghouse for Hazardous Waste, une organisation fondée par Lois Gibbs en 1981 pour fournir des conseils aux nouvelle·aux activistes communautaires, a reconnu que les femmes étaient les principales actrices du mouvement. Parmi ses nombreux manuels de formation, dont un sur la manière de mener une enquête de santé communautaire, l’organisation a publié une brochure intitulée Empowering Ourselves : Women and Toxic Organizing (1989), qui donnait des conseils sur les dimensions politiques de genre de l'activisme70. Le manuel abordait le paradoxe qu'il y avait à s'organiser en tant que mère : dans la vie quotidienne, l'activisme signifiait passer moins de temps avec sa famille, ce qui pouvait conduire à des conflits conjugaux, au divorce, voire à des violences physiques de la part d'un conjoint lassé. Les militant·es de l'épidémiologie populaire et leurs opposant·es étaient parfaitement conscient·es du travail politique que l'activisme genré pouvait accomplir : faire appel à la maternité permettait de mobiliser une tradition de protectionnisme et de justifier l'introduction de l'émotion dans les délibérations, tout en fournissant un moyen pour les opposant·es de délégitimer l'expertise et la voix des militantes, en les accusant d'être des " femmes au foyer hystériques "71.
Les méthodes intimes et géographiques de collecte de données élaborées par les épidémiologistes populaires s'appuient sur des pratiques déjà genrées. En tant que mères, chargées socialement de veiller à la santé de la famille, les femmes de la communauté étaient les informatrices et les organisatrices de l'épidémiologie populaire. Les femmes qui restaient à la maison pour s'occuper des enfants en bas âge avaient la possibilité de prendre conscience des changements subis par leur quartier sur de longues périodes. Elles pouvaient se souvenir de changements dans l'odeur de l'air ou le goût de l'eau, ou dans leurs jardins et leurs animaux domestiques ; elles pouvaient avoir été témoins de déversements illégaux de déchets loin dans le passé, ou elles ou leurs maris pouvaient avoir travaillé dans l'usine du quartier qui faisait l'objet de soupçons. Les épidémiologistes populaires ont multiplié les informations, enregistrant une grande variété de maladies et de symptômes, des éruptions cutanées aux troubles de l'apprentissage en passant par le cancer. Les brochures d'enquête comportaient généralement la mention "autre" et permettaient aux informateur·ices d'apporter des précisions. Leurs conversations avec les voisin·es pouvaient également porter sur des sujets tels que la politique de la ville ou les pratiques du médecin local. Iels ne se limitaient pas à énumérer les maladies, mais recueillaient souvent des anecdotes très personnelles sur les jardins infructueux dans les arrière-cours, l'humidité nauséabonde dans les sous-sols, les visites fréquentes chez le médecin, les diagnostics confus et contradictoires, ainsi que le stress de l'incertitude. Le mode anecdotique a permis aux émotions et aux histoires de vie individuelles de faire partie de l'analyse. Penny Newman, une militante bien connue de la lutte contre les déchets toxiques, a décrit avec éloquence la manière dont les preuves sont fondées sur l'expérience intime : "Alors que d'autres puisent leurs informations dans les manuels et les rapports, nous vivons, respirons et mourons de ce problème. [...] C'est nous qui avons assisté à la dévastation de nos communautés ; nous avons vu des maisons disparaître. Nous sommes celles qui doivent rester éveillées en écoutant nos enfants lutter pour respirer ; qui réconfortent la jeune femme qui vient de subir sa sixième fausse couche. [...] Oui, nous connaissons la question mieux que quiconque.''72 Les observations proviennent de situations sociales genrées, de classe et souvent explicitement racialisées qui incorporent, plutôt qu'elles n'excluent, les connaissances subjectives et émotionnelles.
Pour les militant·es blanc·hes de la lutte contre les déchets toxiques de la fin des années 1970 et des années 1980, en particulier les propriétaires comme cell·eux de l'association des propriétaires de Love Canal, les observations étaient généralement motivées parr l'indignation face à des violations inattendues de la sécurité personnelle de leurs familles. À Love Canal, les propriétaires se sont rendu compte que le parc gazonné au centre de leur quartier recouvrait un site de déchets toxiques vieux de plusieurs décennies73. Ce sentiment de droit à la sécurité provenait d'attentes ancrées, non pas dans un statut de classe subordonnée, mais dans le privilège blanc74. Les pollutions concrétisaient matériellement une tension entre les attentes et la réalité.
Dans les communautés polluées où de nombreux Afro-Américain·es vivaient à proximité d'incinérateurs ou d'usines, comme dans les zones de production chimique et pétrochimique de Louisiane, du Texas et du New Jersey, les habitant·es assistaient quotidiennement, avec leurs yeux et leurs autres sens, au mouvement de la pollution de l'usine vers le quartier75. Les femmes de certains quartiers ouvriers de longue date étaient déjà membres de sociétés de bienfaisance ou de clubs de femmes, tels que le Newtown Florist club, organisés au début du siècle pour collecter de l'argent afin de couvrir les funérailles et les maladies associées à leur quartier industrialisé, ou même pour réclamer de meilleurs services municipaux76. Les militant·es écologistes afro-américain·es avaient tendance à fonder leur analyse sur la justice sociale et les violations des droits civiques, articulant la lutte pour vivre dans un environnement sain avec les luttes pour de meilleures écoles, de meilleurs services municipaux et de meilleurs logements. Pour les communautés afro-américaines de la "Cancer Alley" de Louisiane, par exemple, les habitants ont fait le lien entre la répartition de la pollution et les inégalités structurelles historiquement implantées77. Certaines des premières analyses du "racisme environnemental" utilisaient des codes postaux et des données démographiques gouvernementales sur la race des résident·es pour établir un parallèle entre la répartition des incinérateurs et des décharges et l'emplacement des quartiers pauvres de couleur78. Comme DuBois dans The Philadelphia Negro, les études sur le racisme environnemental mettaient l'accent sur les origines historiques de l'injustice. Ainsi, la vision intime et proche des enquêtes sur la santé communautaire a été utilisée pour démontrer autant des privilèges non respectés que des injustices historiquement sédimentées.
Le raisonnement intime et géographique peut constituer un contrepoids puissant au raisonnement statistique et toxicologique. Si un représentant de l'industrie affirmait qu'un produit chimique n'avait qu'une chance sur dix mille de causer des décès, une militante pouvait reformuler cette évaluation des risques en montrant qu’elle affirmait qu’il était acceptable qu'une personne du voisinage, peut-être un enfant, meure79. Ou si un expert affirmait que l'exposition à un produit chimique ne dépassait pas sa valeur limite, une militante pouvait rétorquer que les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées du voisinage vivaient sous un panache vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et pas seulement entre neuf et dix-sept heures dans une usine sous contrôle80. Alors que la toxicologie traçait les effets des produits chimiques dans un cadre expérimental réduit, l'épidémiologie populaire cartographiait les relations humaines dans un lieu de vie enfumé et incontrôlé. L'assemblage d'outils, de pratiques et de positions de sujets qui structurent l'épidémiologie populaire rend perceptible, non pas des voies causales spécifiques, mais la distribution spatiale des inégalités et des tensions du lieu.
Au moment où le mouvement des femmes employées de bureau a commencé à encourager les enquêtes épidémiologiques populaires sur les bâtiments au début des années 1980, une série d'aides pratiques et de manuels étaient disponibles pour l'épidémiologiste populaire débutant·e81. Le Citizens Clearinghouse for Hazardous Waste de Lois Gibbs, rebaptisé par la suite Center for Health, Environment, and Justice, n'était que la plus importante des nombreuses organisations à but non lucratif qui enseignaient et utilisaient l'épidémiologie populaire. Bien qu'elle ne soit pas institutionnalisée de la même manière que la toxicologie ou l'hygiène industrielle, l'épidémiologie populaire s'est solidement ancrée dans les pratiques du mouvement environnementaliste.
L'épidémiologie populaire a associé les effets sur la santé à la présence physique d'usines, de décharges, d'incinérateurs ou même de produits manufacturés. La cartographie éclaire les conditions proches et diverses d'une exposition chimique plutôt que ses dimensions spécifiques. Au lieu de mettre le doigt sur la cause chimique précise et la réponse physiologique prévisible, les enquêtes sur les lieux ont d'abord façonné un problème de santé global à partir d'un ensemble d'expériences particulières et, ensuite, ont cartographié une collectivité d'effets sanitaires sur une inégalité sociale concomitante ou une tension propre à un lieu. Les enquêtes ont permis de situer un problème dans son lieu et non dans l'individu. Une étude épidémiologique populaire pouvait conclure que "dans ce quartier, le long des vieux ruisseaux, près de ces usines, de nombreuses personnes souffrent d'éruptions cutanées et de maladies respiratoires", ou que "dans cet immeuble de bureaux, dans les bureaux aux fenêtres non ouvrables et à la moquette neuve, de nombreu·ses travailleur·euses ont des problèmes de santé", ou encore que "des décharges toxiques sont situées dans ces quartiers, où vivent des Afro-Américain·es à faibles revenus, et où la prévalence de l'asthme est élevée".
L'épidémiologie populaire a également créé son propre champ d’imperceptibilité. La concomitance, et non la cause, a été appréhendée, laissant l'incertitude demeurer au centre des réactions aux expositions chimiques de faible niveau. Le raisonnement spatial et intime, cependant, n'était pas dépourvu d'une certaine force de persuasion. Pour les non-spécialistes, les cartes étaient plus accessibles que les statistiques et donc utiles pour faire connaître un problème de santé. Par conséquent, l'un des principaux objectifs de l'épidémiologie populaire était de susciter une enquête de l'EPA, de la santé publique ou du NIOSH. L'épidémiologie populaire n'a pas fait mieux que la toxicologie pour identifier un coupable moléculaire ; il s'agissait plutôt d'une technique plus puissante pour appréhender des ensembles d'effets sanitaires non spécifiques causés par des expositions non aiguës dans le monde désordonné de la vie des gens, et non dans la boîte vide d'un laboratoire.
L'existence au point de rencontre
L'hygiène industrielle et l'épidémiologie populaire se sont rencontrées à la fois dans les quartiers pollués et dans les immeubles de bureaux. Le syndrome du bâtiment malsain est né comme un phénomène logé dans cette rencontre. La forme étrange du syndrome du bâtiment malsain a été tracée par ce que chacune de ces pratiques pouvait et ne pouvait pas percevoir au sujet de la nature de la santé environnementale. Comme l'ont montré les chapitres précédents, les immeubles de bureaux ont été construits comme des lieux où le confort et l'efficacité pouvaient être assurés mécaniquement.
Lorsque le vernis d'ambiance bourgeoise du bureau a commencé à s'estomper, l'appréhension naissante des travailleur·euses à l'égard d'un travail de bureau oppressif dans ses détails s'est trouvée confrontée à un environnement bâti conçu pour offrir du confort. À leur tour, les écarts de confort, que les travailleur·euses industriel·les auraient pu accepter avec un haussement d'épaules, sont devenus des signes corporels d'oppression. Ayant facilement accès au papier, au crayon et à la photocopieuse, les employé·es de bureau ont utilisé des méthodes épidémiologiques populaires pour rassembler ces multitudes de plaintes sanitaires en un événement sanitaire à l'échelle de l'immeuble. Les murs de l'immeuble de bureaux sont devenus les limites du phénomène, et le champ mouvant des symptômes en a été l'expression. Ce phénomène, désormais formé par l'ensemble de ses différences, a été confronté aux instruments et aux méthodes de l'hygiène industrielle qui exigeaient que les expositions toxiques soient à la fois régulières et spécifiques, rendant ainsi les expositions omniprésentes et de faible niveau impossibles à prouver et imperceptibles. Le syndrome du bâtiment malsain est devenu un phénomène caractérisé autant par ce qui ne pouvait pas être perçu - la cause spécifique - que par ce qui pouvait l'être. C'est devenu un phénomène dont l'existence même contient de l'incertitude, de la multiplicité et de la non-spécificité.
La forme étrange du syndrome du bâtiment malsain en a fait un problème difficile à cerner. Alors que certain·es pensaient que le SBM n'était rien d'autre qu'une maladie psychogène de masse et d'autres qu'une cause spécifique serait un jour trouvée, le SBM était techniquement défini d'une manière qui maintenait en négociation deux régimes très différents de perception, deux ontologies différentes de l'exposition. Le SBM était simplement un phénomène d'expression : une ''occurrence d'un nombre excessif de plaintes subjectives de la part des occupant·es d'un bâtiment''82. La définition de l'EPA soulignait sa forme acausale, délimitant le SBM comme "un ensemble de symptômes qui affectent un certain nombre d'occupant·es d'un bâtiment pendant le temps qu'iels passent dans le bâtiment. Ils ne peuvent pas être attribués à des polluants ou à des sources spécifiques dans le bâtiment"83. Pour appuyer cette définition non spécifique, un autre terme, celui de 'maladie liée au bâtiment' [building-related illness], a été utilisé pour décrire les cas dans lesquels une cause spécifique a été trouvée, comme dans les cas de légionellose ou de contamination par l'amiante. En bref, si une cause était trouvée, un bâtiment n'était plus atteint du syndrome du bâtiment malsain. La définition étrange du syndrome du bâtiment malsain englobait la non-spécificité à la fois de la cause (pollution non spécifique définie par la toxicologie) et de l'effet (expériences symptomatiques diverses définies par l'épidémiologie populaire). Nous pouvons constater cette rencontre malaisée d'ontologies dans l'explication suivante du SBM, rédigée par deux chercheur·euses universitaires au milieu des années 1980 :
Parce qu'il n'existe pas de définition globale et exhaustive du terme, le syndrome du bâtiment malsain a été considéré avec un certain scepticisme ; cependant, il suffit d'interroger les travailleur·euses d'un bâtiment climatisé pendant un court laps de temps pour se rendre compte de la fréquence des symptômes qu'iels ressentent. La cause n'est pas connue, les symptômes ne sont pas spécifiques, il n'y a rien d'anormal à mesurer et il n'existe pas de test de provocation en laboratoire pour reproduire les symptômes. Il n'est donc pas possible de donner une définition dans les termes scientifiques habituels84.
En d'autres termes, le syndrome du bâtiment malsain était le nom d'un phénomène matérialisé par la rencontre litigieuse de deux manières différentes, mais néanmoins efficaces et révélatrices de la vérité, de matérialiser les expositions chimiques.
Peut-être en partie parce qu'il est né de cette rencontre au lieu d'être le produit d'une seule discipline stable, les qualités non conventionnelles que le nom de syndrome du bâtiment malsain a mis en évidence ont déclenché un débat intense, bien que simpliste, formulé en termes de "tout ou rien" : Le syndrome du bâtiment malsain est-il un phénomène réel, ayant une cause physique, ou non ? Toute recherche historique sur le syndrome du bâtiment malsain est nécessairement une intervention sur ce terrain de tension, notamment en raison des luttes permanentes des personnes pour démontrer les effets de l'exposition aux produits chimiques sur leur vie. La politique de l'exposition aux produits chimiques, que ce soit dans les cours d'eau, les bureaux ou les quartiers, est prise dans un enchevêtrement d'histoires multiples. Chacune de ces histoires peuple le monde de différents types de relations et imprègne les expositions de qualités divergentes, tout en produisant des champs d'imperceptibilité. Ces domaines d'imperceptibilité façonnent fondamentalement les phénomènes, et les cartographier peut nous aider à naviguer dans l'incertitude. Dans cette optique, les termes de la question "réel ou non" sont profondément inadéquats. L'incertitude n'est pas une qualité à résoudre, mais la nature même de l'exposition.
Les scientifiques, elleux aussi, étaient pris·es entre ces deux façons contradictoires de connaître et d'habiter le monde. Iels travaillaient elleux-mêmes dans des bureaux et ne connaissaient que trop bien les limites des méthodes approuvées. Bien que ce chapitre ait mis l'accent sur les pratiques exemplaires des hygiénistes industriel·les, des toxicologues et des épidémiologistes populaires, le déploiement réel de techniques et d'expériences s’est déroulé sur le terrain politique et même contraire à l'éthique de la science d'entreprise, de l'antiréglementation et de l'injustice environnementale racialisée. Les scientifiques du gouvernement, en particulier, ont dû naviguer entre des administrations hostiles, des paysages et des lieux de travail marqués par la ségrégation raciale, et les dénégations des entreprises, pour établir des déclarations positives sur l'exposition aux produits chimiques. L'imperceptibilité, comme l'expliquera le chapitre suivant, n'est pas seulement liée à ce qu'une méthode ou une discipline peut ou ne peut pas faire. L'imperceptibilité était un résultat activement recherché et produit pour que les expositions chimiques deviennent quelque chose contre lequel personne ne pouvait rien faire.
Publication originale (02/2006) :
Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty
· Cet article fait partie de notre dossier Épidémiologie populaire du 21 avril 2023 ·
Wallingford, niosh ieq Health Hazard Evaluation Requests.
U.S. House of Representatives, Indoor Air Quality Act of 1990 Report (May 24, 1990), 37.
For a detailed account of the ciar, see Barnes and Biro, ‘‘Industry Funded Research.’’
Wallingford, niosh ieq Health Hazard Evaluation Requests.
The first published use of the term was in Stolwijk, ‘‘Sick Building Syndrome’’ (1984).
See responses to the first mention of the term sbs in a major journal; Finnegan, Pickering, and Burge, ‘‘Sick Building Syndrome’’ (1985).
7. The first factory inspections of the late nineteenth century targeted women and children. Restrictions on phosphorous, benzene, lead, and radium, some of the earliest chemicals regulated by the state, were also enacted in the name of protecting women. Historian Allison Hepler points out that it was only after the 1870s, when courts struck down laws meant to regulate male workers’ hours and conditions, that reformers turned their attention to women workers; Hepler, Women in Labor.
8. The field of occupational medicine is composed of several different types of experts. The occupational physician is a doctor who specializes in occupational medicine. He or she is trained to identify and treat occupational illnesses and diseases. The industrial hygienist, whose job it is to inspect the health and safety of workplaces, is not typically a physician. Industrial hygienists are experts in the detection of chemicals or hazards in the workplace. They use a different set of tools and do not treat patients but rather search for the causes of occupational illnesses. Reflecting this division, occupational health textbooks are typically ordered by either hazard or organ system.
For an overview of the history of chemistry, see Bensaude-Vincent and Stengers, History of Chemistry; and Brock, Norton History of Chemistry.
Occupational medicine emerged much later in the United States than it did in European countries such as England and Germany, where it developed in the nineteenth century.
On Alice Hamilton, see Hamilton, Exploring the Dangerous Traces; Hepler, Women in Labor; and Sicherman, Alice Hamilton.
That Hamilton was a woman interested in occupational health was not exceptional. On the contrary, in the early twentieth century, women reformers who ran the Consumer League and the Worker’s Health Bureau were important actors in focusing political attention on and instigating protective legislation about industrial work conditions.
Hepler, Women in Labor.
Ibid.
On the history of surveys, see Bulmer, ‘‘Decline of the Social Survey.’’
My account of industrial hygiene in the interwar years borrows heavily from and is indebted to Sellers, Hazards of the Job. I urge any reader wanting to know more about industrial hygiene in this time period to consult it. For the literature on the history of occupational disease in the United States, see Bayer, Health and Safety of Workers; Berman, ‘‘Why Work Kills’’; Claudia Clark, Radium Girls; Corn, Protecting the Health of Workers; Fox, Toxic Work; Judkins, We O√er Ourselves as Evidence; Nelkin and Brown, Workers at Risk; Rosner and Markowitz, Deadly Dust; Rosner and Markowitz, Deceit and Denial; Rosner and Markowitz, Dying for Work; Sellers, ‘‘Factory as Environment’’; Sheehan and Wedeen, Toxic Circles; Barbara Ellen Smith, Digging Our Own Graves; and Weindling, Social History of Occupational Health.
During this period, physical exams were standardized by the insurance industry so that they would both be ‘‘efficient’’—that is, quickly administered —and create data for statistical comparison. On the history of the physical exam, see Audrey Davis, ‘‘Life Insurance’’; and Nugent, ‘‘Fit for Work.’’
For the source of these arguments and a detailed account of the lab at Harvard see chap. 5, ‘‘Pax Toxicologia,’’ in Sellers, Hazards of the Job, 141–86.
Ibid.
Lawrence Henderson, ‘‘E√ects of Social Environment.’’
On lead-poisoning research, see Hepler, Women in Labor; Sellers, Hazards of the Job; and Warren, Brushes with Death.
On history of the acgih, see Corn, Protecting the Health of Workers.
Other countries, such as Canada and many European nations continued to use and develop the mac.
See ‘‘The Political Morphology of Dose-Response Curves,’’ in Proctor, Cancer Wars, 153–73; and Paull, ‘‘Origin and Basis of Threshold Limit Values.’’
On the use of animals in occupational health research, see Messing and Mergler, ‘‘ ‘Rat Couldn’t Speak.’ ’’
The rise of the corporate research lab is nicely documented in a case study of R and D at DuPont. Hounshell and Smith, Science and Corporate Strategy.
Castleman and Ziem, ‘‘Corporate Influence’’; Castleman and Ziem, ‘‘American Conference’’; Markowitz and Rosner, ‘‘Limits of Thresholds’’; Roach and Rappaport, ‘‘But They Are Not Thresholds.’’
Corn, Protecting the Health of Workers, 36–37.
See Murray, ‘‘Regulating Asbestos’’; Ozonoff, ‘‘Failed Warnings’’; Rosner and Markowitz, Deadly Dust; and Rosner and Markowitz, Deceit and Denial.
On the history of workers’ compensation, see Bale, ‘‘ ‘Hope in Another Direction,’ ’’ parts 1 and 2; Berman, ‘‘Why Work Kills’’; Boden, ‘‘Problems in Occupational Disease Compensation’’; Greenwood, ‘‘Historical Perspective’’; and Higgens-Evenson, ‘‘Industrial Police.’’
For example, brown lung, associated with the textile industry, does not show up on X-rays and remains questioned; Judkins, We O√er Ourselves as Evidence.
The exceptions to this rule in the 1970s and early 1980s were specific cases of asbestos, radon, and formaldehyde poisoning, as well as acute outbreaks of pathogens inside ventilation systems, such as the deadly Legionnaires’ disease or humidifier fever.
Hicks, ‘‘Tight Building Syndrome.’’
34. The first U.S. study to meet such standards was published in 1983. Researchers in the Lawrence Berkeley Laboratory studied a San Francisco office building, comparing workers’ symptoms under two different ventila-tion rates, a reduced rate and a higher control rate. These epidemiologists concluded that under conditions of reduced ventilation workers’ symptoms increase. They claimed that pollutant levels did not ‘‘exceed current health standards for outdoor air, nor was any one contaminant found to be responsible. . . . It is possible that a synergistic effect of the various contaminants and environmental conditions may account for the discomfort of occupants’’; Turiel et al., ‘‘Effects of Reduced Ventilation.’’
Bauer, Greve, et al., ‘‘Role of Psychological Factors’’; Boxer, ‘‘Occupational Mass Psychogenic Illness’’; Colligan, ‘‘Psychological E√ects’’; Colligan, ‘‘Review of Mass Psychogenic Illness’’; Faust and Brilliant, ‘‘Diagnosis of ‘Mass Hysteria’ ’’; Guitotti, Alexander, and Fedoruk, ‘‘Epidemiologic Features’’; Kerckho√ and Back, June Bug; Rothman and Weintraub, ‘‘Sick Building Syndrome and Mass Hysteria’’; Ryan and Morrow, ‘‘Dysfunctional Buildings or Dysfunctional People’’; Schmitt, Colligan, and Fitzgerald, ‘‘Unexplained Physical Symptoms’’; Stahl and Legedun, ‘‘Mystery Gas.’’
Colligan and Murphy, ‘‘Mass Psychogenic Illness.’’
Ibid.
Boxer, ‘‘Occupational Mass Psychogenic Illness.’’
Colligan and Murphy, ‘‘Mass Psychogenic Illness.’’
Singer et al., ‘‘Mass Psychogenic Illness.’’
Boxer, ‘‘Occupational Mass Psychogenic Illness.’’
Colligan and Murphy, ‘‘Mass Psychogenic Illness.’’
Phil Brown, ‘‘Popular Epidemiology.’’
Allan, Uneasy Alchemy; Phil Brown, ‘‘Popular Epidemiology’’; Brown and Ferguson, ‘‘ ‘Making a Big Stink’ ’’; Brown and Mikkelsen, No Safe Place; Bullard, ‘‘Environmental Justice for All’’; Di Chiro, ‘‘Defining Environmental Justice’’; Di Chiro, ‘‘Local Actions, Global Visions’’; Fischer, Citizens, Experts and the Environment; Kim Fortun, Advocacy after Bhopal; Krauss, ‘‘Blue-Collar Women and Toxic-Waste Protests’’; Krauss, ‘‘Women and Toxic Waste Protests’’; Krauss, ‘‘Challenging Power.’’
Popular epidemiology was crucial, for example, in identifying incidents of toxic contamination by General Electric of Pittsfield, Mass.; by the Pelham Bay dump in a Bronx, N.Y. neighborhood; by Martin Marietta Corporation in Friendly Hills, Colo.; by Velsicol Chemical Corporation in Hardeman County, Tenn.; and by W. R. Grace and Company and Beatrice Foods in Woburn, Mass.; Brown and Mikkelsen, No Safe Place, 127; Frumkin and Kantrowitz, ‘‘Cancer Clusters in the Workplace.’’ It has also been important in the environmental justice movement, such as in the attempt to litigate a claim of environmental racism in the Northwood Manor neighborhood of Houston in 1979; Blum, ‘‘Pink and Green.’’
The best work on the history of the social survey movement is Bulmer, Bales, and Sklar, Social Survey.
College Settlements Association, Fourth Annual Report, 22–23; quoted in Katz and Sugrue, W. E. B. DuBois, 14.
Bulmer, ‘‘W. E. B. Du Bois’’; Katz and Sugrue, W. E. B. DuBois.
DuBois, Philadelphia Negro, 1.
Bay, ‘‘ ‘World Was Thinking Wrong.’ ’’
DuBois, Philadelphia Negro, 8.
Ibid.
Lasch-Quinn, Black Neighbors.
Sklar, ‘‘Hull-House Maps and Papers.’’
Sinclair-Holbrook, ‘‘Map Notes and Comments,’’ 11–12.
Ibid., 11.
Ibid., 5.
On ‘‘geographical sentiment’’ at Hull House, see Sklar, ‘‘Hull House Maps and Papers.’’
Kelley, ‘‘Hull House,’’ 550.
DuBois, Autobiography, 198; DuBois, Philadelphia Negro, 3.
DuBois, Souls of Black Folk, 4.
Steven Cohen, ‘‘Pittsburgh Survey.’’
Bulmer, Bales, and Sklar, ‘‘Social Survey,’’ 30.
Bulmer, ‘‘Decline of the Social Survey.’’
Beck, ‘‘Industrial Society to Risk Society.’’
Carson, Silent Spring, 168.
On popular epidemiology as citizen science, see, Di Chiro, ‘‘Local Actions, Global Visions’’; and Fischer, Citizens, Experts and the Environment.
Murphy, ‘‘Immodest Witnessing.’’
For an expansive discussion of maternalism in American women’s environmental activism, see Blum, ‘‘Pink and Green.’’
Zeff, Love, and Stults, Empowering Ourselves.
Theresa Freeman, ‘‘Vermonters Organized,’’ 43.
Quoted in Di Chiro, ‘‘Defining Environmental Justice,’’ 120.
For accounts of Love Canal, see Blum, ‘‘Pink and Green’’; Fowlkes and Miller, ‘‘Chemicals and Community’’; Gibbs, Love Canal; Levine, Love Canal; and Mazur, Hazardous Inquiry.
Krauss, ‘‘Blue-Collar Women and Toxic-Waste Protests’’; Lipsitz, Possessive Investment.
For more on the way racialized distributions of privilege and disadvantage shaped the science of indoor pollution, see chap. 5.
On the Newtown Florists Club, see Spears, ‘‘Environmental Justice.’’ On the importance of benevolent societies and women’s clubs in early African American women’s environmentalism, see Blum, ‘‘Pink and Green.’’
Allan, Uneasy Alchemy; Rosner and Markowitz, Deceit and Denial.
Bryant and Mohai, ‘‘Environmental Injustice’’; Bullard, ‘‘Environmental Justice for All’’; General Accounting Office, ‘‘Siting of Hazardous Waste Landfills,’’ 83–168; United Church of Christ Commission on Racial Justice, Toxic Wastes and Race.
Newman, ‘‘Killing Legally.’’ Also see Di Chiro, ‘‘Defining Environmental Justice.’’
Newman, ‘‘Killing Legally.’’
Cohen and O’Connor, Fighting Toxics; Environmental Action Foundation, Making Polluters Pay; Legator, Harper, and Schott, Health Detectives Handbook.
Stolwijk, ‘‘Sick-Building Syndrome’’ (1991), 99.
U.S. Environmental Protection Agency, ‘‘Inside Story,’’ 35.
Finnegan and Pickering, ‘‘Building Related Illness,’’ 391.