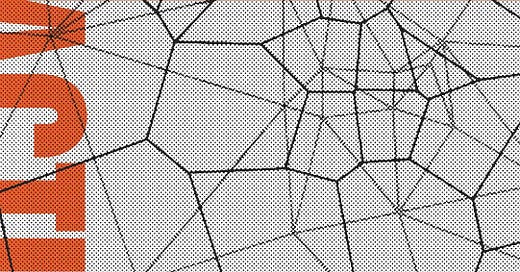La statistique, outil de pouvoir ou de libération ? | Luc Boltanski, Alain Desrosières
De fait, Marx et Engels utilisaient largement les statistiques des manufactures de leur époque pour analyser et critiquer le capitalisme.
Luc Boltanski est sociologue et directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il a publié de nombreux ouvrages dont De la justification : les économies de la grandeur (1991) avec Laurent Thévenot, Le nouvel esprit du capitalisme (1999) avec Eve Chiapello, ou Énigmes et complots (2012).
Alain Desrosières (1940-2013) a été administrateur de l'Insee, membre du département recherche de cet institut et membre du Groupe de sociologie politique et morale (EHESS/CNRS). Il est l'auteur de Les Catégories socioprofessionnelles (1988) avec Laurent Thévenot, La Politique des grands nombres : Histoire de la raison statistique (1993), et Prouver et gouverner. Une analyse politique des statistiques publiques (2014).
Les deux textes qui suivent constituent les première lignes des chapitre respectifs de Luc Boltanski et Alain Desrosières du livre Statactivisme,
Comment lutter avec des nombres (Zones, 2014). La totalité de l’ouvrage ainsi que les notes sont entièrement accessible sur le site de la maison d’édition.
· Cet article fait partie de notre dossier Épidémiologie populaire du avril 2023 ·
Quelle statistique pour quelle critique ?
Luc Boltanski
Les questions qui surgissent à l’intersection de la statistique et de la critique se sont formées au cours d’une histoire conflictuelle qui, sans être toujours explicitement rappelée, ni même parfois, peut-être, présente à l’esprit des statisticiens de terrain, n’en demeure pas moins sous-jacente aux débats les plus actuels, un peu à la façon d’un inconscient. Elles s’enracinent dans les tensions anthropologiques et politiques qui ont accompagné le développement des statistiques sociales, non seulement en tant que modes de représentation des êtres et de leurs actions prenant appui sur les mathématiques, mais, surtout, en tant qu’outils de gouvernement de ce qui, au cours du XIX e siècle, a pris le nom de sociétés. Or ce terme désignait des populations et des territoires, supposés homogènes ou en voie d’homogénéisation, dont les contours se superposaient, en fait, à ceux des États-nations, auxquels les pouvoirs de totalisation de la statistique contribuaient à conférer une représentation objectivée.
Cette histoire est aujourd’hui bien documentée, particulièrement, en France, grâce à Alain Desrosières dont les magnifiques travaux ont accompagné et, en nombre de cas, précédé la diffusion des problématiques d’inspiration foucaldienne qui constituent aujourd’hui le cadre au sein duquel sont souvent analysées les relations entre représentation statistique et action politique. Retracer cette histoire – même à partir de sources de seconde main – excéderait largement le cadre de cette intervention. Mais il peut être néanmoins utile de rappeler la situation qui prévalait dans les années 1960, période durant laquelle la statistique a commencé, surtout en France, à faire l’objet non seulement d’une utilisation gouvernementale, mais aussi d’un usage critique, et cela sur une large échelle.
La défense réactionnaire de la « singularité » contre la statistique sociale
Dans l’atmosphère intellectuelle qui prévaut en France au cours des années d’après guerre, les approches statistiques furent confrontées à des oppositions allant de la méfiance à une sorte de mépris. Ces dernières ne prenaient pas appui sur un rejet des formes de contrôle étatiques, qualifiées de « technocratiques », qui aurait pu se réclamer des courants libertaires et, par exemple, de leur résistance aux recensements, mais sur des traditions spiritualistes, retraduites dans l’idiome du personnalisme ou de la phénoménologie. Partant des personnes et de leur relation au monde, considérées comme toujours singulières, ces approches mettaient en cause les formes totalisantes qui se réclamaient de la sociologie, particulièrement, dans ses expressions durkheimiennes, et qui entendaient identifier des phénomènes spécifiquement « sociaux », relativement indépendants des volontés, des intentions et des motifs d’ordre individuel. L’approche individualisante mettait ainsi l’accent sur la primauté de la différence, sur la valorisation des personnes en tant que sujets, dotés d’une conscience et susceptibles par là de choix moraux, sur la responsabilité, et sur la liberté ontologique des êtres humains, auxquels elle opposait l’abandon à la volonté impersonnelle de la foule, de la masse, de l’opinion (le « on »), ou même la dictature de la norme qui neutralise les consciences et les plonge dans l’enfer du banal. À l’inverse, le genre d’approches qui cherchaient à tirer parti des opérations de totalisation statistique mettait l’accent sur la puissance des effets systémiques et sur les contraintes, voire sur les déterminismes dits « sociaux », auxquels les agents devaient se plier, parfois, ou souvent, sans même être en mesure de les identifier en tant que tels.
Cette opposition était, dans une large mesure, polarisée politiquement. Tandis que les approches individualisantes ou personnalisantes étaient souvent adoptées par des auteurs que leur évolution allait conduire vers la droite ou l’extrême droite (comme ce fut le cas, par exemple, de Jules Monnerotnote), les approches totalisantes, utilisant l’outil statistique, étaient plutôt revendiquées par des auteurs se réclamant de la gauche et, souvent, du socialisme ou du communisme. Il leur était en effet reconnu une puissance critique pour la raison suivante. En mettant au jour des effets systémiques susceptibles de s’imposer aux agents sociaux, mais de façon différentielle, elles étaient créditées de la capacité à dévoiler les asymétries sociales et elles étaient utilisées, par là, pour disculper les acteurs dont les conduites étaient mal jugées de l’accusation d’être eux-mêmes responsables des maux, soit qu’ils s’infligeaient, soit aussi, d’ailleurs, qu’ils infligeaient aux autres. Traités, au moins implicitement, par les approches individualisantes comme fautifs ou comme incapables (comme stupides, paresseux, ivrognes, brutaux, etc.), ou condamnés pour leur passivité, ces acteurs dévalorisés pouvaient être considérés, depuis des positions critiques, en tant que victimes de processus sociaux d’exploitation et/ou de domination, sur lesquels ils n’avaient pas prise. Du même coup, les approches individualisantes et moralisantes pouvaient être accusées à leur tour de ne rien faire d’autre que de « blâmer les victimes ». […]
La statistique, outil de libération ou outil de pouvoir ?
Alain Desrosières
La critique sociale prend souvent appui sur des arguments statistiques. Ceux-ci visent à exprimer et à rendre visibles des exigences d’égalité et de justice. La confiance accordée à ce type d’outils a cependant été érodée, dans la période récente, par la montée en puissance des politiques d’inspiration néolibérale. En effet celles-ci utilisent largement des « indicateurs » quantitatifs pour contrôler les acteurs sociaux et les mettre en concurrence à travers des techniques comme le benchmarking. La statistique est-elle un outil de libération ou un outil de pouvoir ? La question peut sembler saugrenue pour qui a connu l’époque optimiste des années 1950 à 1970, où l’information fournie par la statistique publique était vue comme une des composantes majeures d’une société démocratique.
Cet optimisme peut aujourd’hui être réinterrogé, non seulement du fait des usages de la quantification par les pratiques de gestion néolibérales, mais aussi en prenant en compte les apports des recherches historiques et sociologiques menées sur la quantification depuis trois décennies. Ces travaux ont parfois pu donner, à tort, l’impression de relativiser, sinon de disqualifier, les arguments statistiques, par exemple à travers la floraison d’écrits sur la « construction sociale de ceci ou cela », finement analysés par Ian Hacking. En historicisant et sociologisant les productions statistiques, ces études semblaient en affaiblir la portée, en leur ôtant leur efficacité liée à leur image d’objectivité et d’impartialité. Les controverses fréquentes sur la mesure du chômage ou de l’inflation ne pouvaient que renforcer une méfiance par rapport à ce qui est trop souvent présenté comme des « chiffres indiscutables ». Pourtant, ces travaux ont permis de prendre du recul par rapport à des productions dont la discussion semblait réservée à des experts, en raison de leur technicité apparente, et de créer des espaces de débat public à leur propos, dont les colloques réguliers organisés par les syndicats de la statistique publique donnent de bons exemples.
La statistique comme « outil de faiblesse » aux mains des opprimés
La démocratie et la statistique ont en commun l’idée qu’il est possible de comparer et de « commensurer » les citoyens. Le principe d’égalité issu de la Révolution française est d’abord juridique, au XIX e siècle : un homme, une voix. Mais les femmes en sont exclues, non commensurables. À cette époque, les enquêtes sur les budgets et les conditions de vie, menées par Frédéric Le Play, ne portent que sur les classes populaires. Il est encore inconcevable d’interroger les bourgeois et de les comparer aux ouvriers. Puis, au XX e siècle, l’exigence d’égalité devient sociale, les enquêtes statistiques comparent les groupes sociaux, les femmes et les hommes. L’extension des droits sociaux et des systèmes de protection sociale est liée à une extension du domaine des questions pouvant faire l’objet d’enquêtes statistiques.
L’historien américain Ted Porter a analysé ce recours à l’argument statistique en parlant, de façon paradoxale, d’« outil de faiblesse ». La statistique est en effet souvent présentée comme un outil de pouvoir, en suggérant, selon un raisonnement classique, que les classes dominantes orientent la production statistique en fonction de leurs intérêts. Porter suggère, au contraire, que l’hégémonie des classes traditionnelles est souvent fondée sur l’implicite, l’évidence non interrogée, vécue comme « naturelle ». L’argument statistique est alors mis en avant par les groupes dominés pour casser l’ordre ancien et rendre visible l’injustice. Plus finement, ce recours est souvent (mais non toujours) le fait de fractions dominées de la classe dominante, des classes moyennes plus scolarisées et mieux dotées en ressources pour construire l’argumentaire.
La première vague de construction des bureaux de statistique publique a lieu dans les années 1830 à 1860, sous l’impulsion d’Adolphe Quetelet. Cette statistique est constituée, d’une part, par les recensements de population et, d’autre part, par la compilation de registres administratifs de l’état civil (naissances, mariages, mortalité, morbidité, suicides) et de la justice (crimes et délits). Cette première statistique est interprétée par Quetelet en termes d’« homme moyen » et de régularité de phénomènes sociaux comme les crimes et les suicides. Elle contribue à diffuser l’idée que les sociétés peuvent être analysées en termes globaux, macrosociaux, relativement indépendants des comportements des individus. Cette idée peut être utilisée dans une perspective conservatrice (on ne peut rien changer), mais aussi dans une perspective critique : si les rapports sociaux sont indépendants de l’éventuelle bonne volonté individuelle des puissants, c’est tout le système qu’il faut changer. C’est bien de cette façon que raisonnaient Marx et, plus tard, les socialistes : ce ne sont pas les capitalistes qu’il faut changer, mais le capitalisme lui-même. De fait, Marx et Engels utilisaient largement les statistiques des manufactures de leur époque pour analyser et critiquer le capitalisme.
La deuxième grande vague de développement de la statistique est liée à la grande crise économique et sociale des années 1870 à 1890. En Angleterre, deux interprétations très différentes de la crise s’opposent alors. La première, biologisante, prend appui sur des arguments statistiques sur la supposée hérédité des aptitudes pour prôner des politiques eugénistes. La seconde, plus sociologique, décrit les conditions de vie des classes populaires, à partir d’enquêtes statistiques qui nourriront les projets des réformateurs sociaux et du mouvement travailliste (Beatrice et Sidney Webb, lord Beveridge). En Allemagne, les syndicats ouvriers organisent de grandes enquêtes sur les salaires et l’emploi. En France, une tradition plus ancienne d’enquêtes sur les budgets ouvriers avait été initiée par un ingénieur catholique conservateur, Frédéric Le Play. Celui-ci reprochait au salariat capitaliste d’avoir déraciné les ouvriers de leurs solidarités anciennes, traditionnelles et familiales. Cette critique, venue pourtant d’un milieu conservateur allergique à la Révolution française, engendrera un mouvement d’enquêtes et de réformes sociales, dont le Musée social à Paris est un avatar.
Publication originale (15/05/2014) :
Zones
· Cet article fait partie de notre dossier Épidémiologie populaire du avril 2023 ·